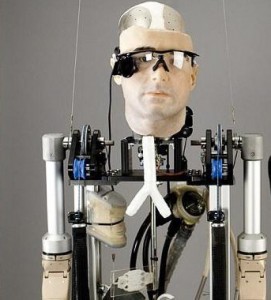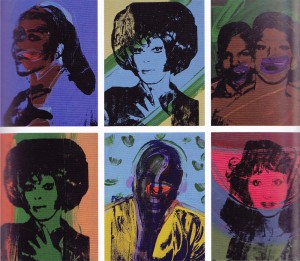Deviens ce que tu es ou: Deviens qui tu es. La première occurrence de cette 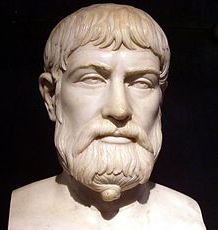 formule se trouve chez Pindare, poète grec du 5ème siècle avant notre ère. Elle a été reprise jusqu’à nos jours par de nombreux philosophes et écrivains.
formule se trouve chez Pindare, poète grec du 5ème siècle avant notre ère. Elle a été reprise jusqu’à nos jours par de nombreux philosophes et écrivains.
A première vue, cette maxime met en valeur un « devenir-soi » très à la mode, qui pourrait bien convenir à notre époque d’individualisme obligé et de narcissisme compulsif. Des essayistes travaillent ce thème, sur le mode néo-hédoniste de Michel Onfray (La Sculpture de soi, 1993) ou sur le mode crypto-libéral de Jacques Attali (Devenir soi, 2014). Mais pourquoi ne pas lui préférer : Deviens ce que tu n’es pas, un « devenir-autre », quitte à s’égarer sur des chemins de traverse ? Et puisqu’il est illégitime de faire de Soi le Robinson d’une île dépeuplée, pourquoi pas un Devenons ce que nous sommes, voire un Devenons ce que nous ne sommes pas: un « devenir-commun » à élucider, qui convoque cette fois le groupe, le peuple, la multitude ?
Je propose ici un parcours à travers différents interprétations de la formule, la confrontant au passage avec d’autres maximes qui lui font écho, sur un vecteur qui va du devenir-soi à un devenir-commun en passant par un devenir-autre.
A la double menace du libéralisme (qui pousse l’individualisme jusqu’à effacer le commun et détruit la planète) et du fondamentalisme religieux (qui pousse l’appartenance au groupe jusqu’à effacer l’individualité et détruit la culture) répond ici le projet d’un « commun » incluant la singularité du « soi ». Ce projet, qui mène ici d’un devenir-soi à un devenir-autre, sera poursuivi vers un devenir-commun dans un article ultérieur où seront interrogées les alternatives à l’économie prédatrice et les pratiques d’innovation sociale aussi bien dans les communautés indiennes d’Amérique qu’à côté de chez nous.
Sommaire
| 1.Paradoxe. 2. Antiquité. L’être-présent et le champ du possible 3. Renaissance. Achève ta propre forme 4. Qui es-tu donc ? 5. Qui deviens-tu ? 6. Kant. Pense par toi-même 7. Hegel et la dialectique du devenir 8. Nietzsche. Deviens celui que tu es 9. Freud-Lacan. Qu’advienne le sujet 10. Beauvoir-Sartre. Deviens ce que tu n’es pas 11. Deleuze-Guattari. Devenir-autre 12. Transhumanisme. Deviens illimité ? Conclusion. Devenir-soi, devenir-autre, devenir-commun |
Avertissement en guise de conseil de lecture
Le lecteur pourra avoir une compréhension rapide et plus intuitive des idées de l’article en sautant tout ou partie des chapitres 6 à 11 qui sont centrés sur des théories philosophiques (Kant et Hegel avec leur attention à l’universel; Nietzsche, Freud et Deleuze avec leur souci du singulier), quitte à y revenir ensuite.
1. Paradoxe
Deviens ce que tu es ou deviens qui tu es: j’utiliserai les deux formulations quoiqu’elles ne soient pas identiques. La première met l’accent sur les prédicats qu’on peut attribuer à une personne, traits de caractère ou données biographiques; la seconde met l’accent sur le sujet qui supporte ces prédicats, sur l’identité personnelle avec ses possibles propres. L’une paraît fermée sur un déterminisme, l’autre laisse ouverte des virtualités. D’un côté plutôt un « Moi » habillé d’une image publique, de l’autre un « Soi » c’est-à-dire à la fois une profondeur invisible et une capacité de réflexivité.
Sous une forme ou l’autre, la maxime est apparemment contradictoire, en tout cas paradoxale. Comment pourrais-tu devenir ce que tu es ? Si tu l’es, c’est que tu n’as pas à le devenir, si tu le deviens c’est que tu ne l’es pas. Si on dit à l’élève d’une école de cirque: deviens jongleur, c’est justement parce qu’il ne l’est pas : dans ce cas, c’est donc : deviens ce que tu n’es pas (encore). Par contre, il est vexant de dire: deviens jongleur, à un jongleur professionnel, à celui qui l’est (déjà).
Sur le plan conceptuel, être et devenir, sont des contraires. A l’orée de la philosophie, à l’époque même de Pindare, c’est sur ce doublet que s’opposent l’Etre immuable de Parménide et le Devenir universel d’Héraclite. Pour le premier, le devenir n’est qu’apparaître et jeu de langage : « le non-être n’est pas » (Poème) ; pour le second, l’être est conflictuel et le non-être a une réalité : « nous sommes et ne sommes pas » (B,49a). Notre formule, précisément, conjoint ces opposés, être et devenir.
De plus, l’impératif deviens, consiste en une prescription venue d’un autre qui t’appelle à te réaliser authentiquement toi-même. Sa modalité est indéterminée : simple invite, conseil ou obligation morale ? Quoi qu’il en soit, c’est une injonction paradoxale :
comment peut-on recevoir de l’extérieur un commandement à exercer son vouloir propre ? Si on te dit « sois libre, lance-toi », par ce seul fait, tu ne seras plus tout à fait libre de ce que tu veux, ta décision sera sous influence.
2. Antiquité. L’être-présent et le champ du possible
Justement, la formule de Pindare (518-438 avant notre ère), adressée à Hiéron 1er, à la fois tyran éclairé de Syracuse et athlète renommé, ajoute une précision: « Deviens qui tu es, quand tu l’auras appris » (Γένοι’ οἷος ἐσσὶ μαθών, Pythiques, II). Peut-être en l’apprenant de moi, suggère Pindare, conseiller du Prince ; plus sûrement en l’apprenant par toi-même. Qui tu es réfère à la naissance, à l’héritage d’une lignée et aux virtualités d’une nature propre. N’est-ce pas Pindare qui s’adressait ainsi à lui-même: « O mon âme, n’aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible » (Pythiques, III).
Voilà une solution de l’injonction paradoxale : deviens ce que tu es, c’est une parole que tu peux t’adresser réflexivement à toi-même : le tu ainsi énoncé y redouble le je élidé de l’énonciation à l’impératif – non sans introduire une forme d’altérité en toi-même.
Quelques siècles plus tard, le poète latin Martial (40-104) reprend la formule, mais pour lui donner une tournure moins flamboyante: « se contenter d’être ce que l’on est, et ne rien désirer de plus » (Epigrammes, X, 47, 12), la transformant en maxime d’un bonheur fait d’acceptation de son sort. Dans la même veine, Horace (65-9 avant notre ère) déjà, entre épicurisme et stoïcisme, vantait la modération comme vertu, et appelait chacun à écarter la crainte et l’espérance pour profiter pleinement du moment présent: « Cueille le jour sans te soucier du lendemain » (Carpe diem quam minimum credula postero, Odes I, 11, 8), règle de la tranquillité d’âme et non pas d’un hédonisme effréné.
Nous voilà donc face à deux ententes différentes de la maxime, la première ouverte sur le possible, la deuxième fermée sur le présent: accepter de s’égarer ou rester « chez soi » ?
3. Renaissance. Achèves ta propre forme
Une autre ligne de pensée, articulée à une idée nouvelle de l’homme, naît à la Renaissance, avec l’humanisme, se développe à l’époque classique, s’épanouit avec les Lumières et se poursuit jusqu’à Hegel, Comte ou Marx. Elle stipule une « perfectibilité » de l’homme, un progrès de l’existence humaine vers la réalisation effective de l’humanité des hommes.
Pic de la Mirandole dans le Discours de la dignité de l’homme (1486) affirmait que l’homme, microcosme placé au milieu du monde, est un être indéfini, à la différence des bêtes et des Esprits qui ne sont que ce qu’ils sont pour toujours. Il s’adresse ainsi à l’homme : « souverain de toi-même, tu achèves ta propre forme librement, à la façon d’un peintre ou d’un sculpteur ». Pic de la Mirandole imagine un devenir végétal, un devenir animal, un devenir céleste de l’homme selon la forme de vie qu’il adopte, à partir des multiples germes qui sont en lui.
Erasme se trouve sur une ligne semblable lorsqu’il déclare « On ne naît pas homme, on le devient » dans De l’éducation des enfants (1519). Il a en vue l’homme générique qui, à la différence de l’animal, doit se former pour devenir pleinement humain, pour réaliser sa nature d’être raisonnable. L’humanité de l’homme est une tâche, c’est le résultat d’une éducation, particulièrement par le moyen des humanités, c’est-à-dire de l’étude de la culture antique. Erasme, contre Luther, affirme le libre-arbitre de l’homme, mais, comme lui, il se situe dans la perspective d’une « modernisation » de la religion chrétienne. Aussi, dans ces deux cas, le but visé est le même – c’est le salut -, il est fixé d’avance.
L’idée d’un dénuement de l’homme à sa naissance est déjà présente dans le mythe de Prométhée. Anthropologiquement, cette idée d’un devenir-humain de l’homme, rejoint le concept de néoténie : l’homme naît « prématuré », marqué par un manque qui rend nécessaire l’invention de la culture. Il est l’animal qui a la plus longue période de formation avant sa maturité, c’est-à-dire qu’il est sous la dépendance absolue des autres, hors desquels il ne peut survivre. Ainsi tu n’es pas seulement ce que tes gènes portent, tu es aussi et surtout ce que ton milieu fait de toi, avant d’être ce que tu fais de toi-même, dans la situation ou tu es jeté.
Et ceci vaut non seulement pour l’homme comme individu, mais aussi pour l’humanité, dans son histoire : à l’évolution biologique s’est substituée une évolution de la civilisation.
La mutation de l’image de l’homme depuis la Renaissance accompagne en effet une mutation sociale-historique. L’Ancien monde de la tradition immuable (ou du moins à l’évolution imperceptible) est remplacé par la Modernité faite d’un changement continu, recherché, assumé sur tous les plans : sciences, arts, politique. Le devenir prend le devant sur l’être immuable. La liberté individuelle s’affirme, l’histoire est pensée comme la possibilité d’un progrès illimité. Sur cette ligne surgit la visée d’une émancipation des hommes par la Raison et sa contrepartie, la démesure d’une croyance en la toute-puissance de l’homme, capable d’une domination totale de la nature et d’une transformation radicale de la société. D’un deviens ce que tu es, on a glissé vers un deviens ce que tu n’es pas.
4. Qui es-tu donc ?
Faisons un premier point avant d’aborder le siècle des Lumières.
Deviens ce que tu es comporte deux présuppositions, dont chacune d’ailleurs peut être discutée : 1) Tu es quelque chose, ou mieux quelqu’un de déterminé (ton individualité corporelle et ton identité sociale, mais plus encore ton « identité personnelle ») ; 2) tu peux vouloir ou ne pas vouloir le devenir. Une ouverture contre une fermeture. Comment le comprendre ?
Tu es quelqu’un, mais qui donc ? S’agit-il de tes gènes dont l’expression fera ton devenir ? Mais on n’a pas besoin de dire deviens ce que tu es à l’oeuf qui deviendra poussin, et de poussin, poulet: la chose colle à sa peau comme une étiquette.
Quant à toi, humain, tu es tes gènes (et non tu les « as »), mais tu es aussi ce que l’éducation a fait de toi, dans tel milieu, dans telle époque. Tu ne t’es pas créé ni choisi toi-même, mais tu as été façonné par une hérédité et un héritage avant de te lancer sur le chemin de ta vie.
Si tu veux devenir ce que tu es, il faudra d’abord te connaître, Pindare le remarquait déjà. Socrate le prolonge en reprenant la maxime delphique : Connais-toi toi-même. Cette connaissance viendra de ton propre fonds, Socrate se revendiquant de n’être qu’un accoucheur et affirmant pour sa part ironiquement : « je sais que je ne sais rien ». Mais dans l’acception socratique, se connaître c’est se débarrasser des illusions du relativisme et découvrir les vérités qui sommeillent en nous, des vérités universelles, les mêmes pour tous.
Dans l’acception courante, se connaître, au contraire, c’est découvrir sa singularité propre dans l’appartenance à l’universelle condition humaine. C’est un moment émancipateur, le moment d’une prise de distance par rapport à soi, qui induit une modification de soi. C’est donc la production d’un devenir-autre. Cependant cette connaissance de soi est forcément trompeuse, lacunaire, incertaine, habitée par des émotions qui échappent au scalpel de la connaissance. Ce que tu es est multiple, ouvert sur des possibles, intermittent, contradictoire. Montaigne disait : « découvrir moi-même, qui serai par aventure autre demain » (Essais, I,26). Se connaître, c’est donc choisir, se choisir une vérité ou identiquement une erreur. Méconnais-toi toi-même, c’est ton sort.
De plus, le rapport à soi passe par le rapport à l’autre. Ce que tu es est traversé d’imaginaire et de symbolique. D’imaginaire : ta personnalité se construit par des identifications à d’autres, où l’altérité finit par s’effacer dans l’identité ; tu ne te connais qu’à travers l’image que te renvoie le regard des autres : ce n’est pas toi qui décides de ta générosité ou de ton égoïsme dans le théâtre social. De symbolique : tu te connais dans l’élément même du langage, un ordre du langage qui vient des autres et dont tu hérites, et dans un discours dont les signifiants t’assignent un nom, une place dans les générations, un sexe.
Sans doute tu es capable de ré-flexion, tu peux te voir toi-même comme de l’extérieur, comme un autre, mais pour te perdre aussitôt : le Je qui regarde ton Moi est lui-même soustrait de ce Moi. Quelque chose échappe toujours, ne serait-ce que cet oeil, le tien, lorsqu’il te regarde et ne voit de lui-même au mieux qu’une image inversée dans le miroir. Tu sais et tu ne sais pas qui tu es, et le devenir-soi n’est donc jamais qu’une aventure incertaine.
Jean-Jacques Rousseau indique une piste : « Quiconque a le courage de paraître toujours ce qu’il est deviendra tôt ou tard ce qu’il doit être » (à Madame d’Houdetot, 13 juillet 1757.) Non pas donc « paraître ce qu’on n’est pas » dans une posture qui est une lâcheté et une tromperie – mais « être », ou mieux : « paraître ce qu’on est », simplement, dans la pure identité à soi-même, tel qu’on peut se vivre sans être asservi par le regard des autres.
Essaye donc de connaître qui tu es, toi-même, authentiquement, et d’agir en conséquence. Tu pourras alors devenir Toi au lieu de te faire à l’image du désir de l’autre. Tu découvriras ta « personnalité profonde » qu’il te reste à accomplir. Soit. Mais on en revient toujours au même obstacle : où donc se trouve enfoui ce trésor mythique, si profondément que tu passeras ta vie à courir après? Qu’est-ce qui garantit que dernière ton masque social il n’y a pas encore d’autres masques ? ou encore que prendre un masque, c’est justement ce à quoi tu veux jouer, à ta manière propre ?
Ta personnalité, tu en connais quelques traits, il y a cette ritournelle qui t’habite, la fidélité à un désir, quelques convictions. Et en même temps, c’est cet obscur dispositif inachevé, fait de parties censurées et d’autres complaisamment exposées, où surface et « profondeur » sont indissociables et dont l’image est animée par le désir de reconnaissance.
5. Qui deviens-tu ?
Deviens ce que tu es est une formule de l’identité close excluant l’autre. Tu es Français, deviens Français, réalise pleinement cette appartenance, ne cherche pas un illusoire métissage; tu es étranger, tu resteras étranger, tu ne peux devenir ce que tu n’es pas. Tu occupes une place dans la société, reste là où tu es, accomplis juste ton destin. Aussi bien: tu es un délinquant de bas ou de haut vol, tu resteras délinquant – tant pis, fais-le bien, dira le cynique. Tu es compatissant et généreux, tant mieux, continue de l’être.
A moins que tu ne sois pas ceci ou cela dans une définition close. Des virtualités multiples sommeillent en toi et tu peux choisir de les accomplir, transformant la puissance en acte, réalisant telle capacité plutôt que telle autre. Mais ces virtualités, tu ne peux les connaître qu’en les actualisant, tu ne peux savoir si et comment d’autres virtualités étaient possibles: l’essai de ta vie, c’est ta vie même. C’est cela ta finitude : les possibilités sont peut-être infinies, mais en choisir une, c’est abandonner les autres.
Cette notion de virtualité est une explication circulaire : c’est arrivé parce que c’était virtuel, c’était virtuel puisque c’est arrivé. Je lui préfère la notion d’ « émergence », l’apparition de quelque chose de neuf et d’imprévisible, irréductible au déjà-là et qu’il dépend de toi d’accueillir. L’idée d’émergence me paraît plus féconde, plus pragmatique, faisant signe vers un possible à oser, tandis que celle de virtualité est plus métaphysique, désignant un possible déjà là.
Ainsi, ta « personnalité » énigmatique n’est pas une donnée toute faite de la naissance et de l’éducation, c’est un devenir, c’est ce que tu fais par tes choix. Si les formes de vie qui sont les tiennes sont déterminées par ce que tu es, alors pas besoin de dire « deviens » ; si tu es capable de choix libre, alors tu deviens, mais tu ne deviens pas nécessairement ce que tu es, tu passes à un autre que toi, dans une différence avec toi-même.
Comme telle, la « liberté de choix » est un postulat, un pari sur le libre-arbitre ; le rabat-joie pourra toujours dire : tous tes choix sont prédéterminés par ce que tu es, ta liberté est une illusion.
6. Kant. Pense par toi-même
« Les Lumières, c’est la sortie de l’homme hors de l’état de tutelle dont il est lui-même responsable. L’état de tutelle est l’incapacité à se servir de son entendement sans la conduite d’un autre (…) Sapere aude! Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des lumières », déclare Kant dans Qu’est-ce que les Lumières? (1784), devise empruntée au poète Horace et qu’il reformule aussi en : « pense par toi-même ». Voilà une autre forme de l’injonction paradoxale: on t’ordonne de ne pas recevoir d’ordre pour ce qu’il en est de l’exercice de ta pensée.
Et Kant annonce la couleur : il y faut du courage, le courage de se libérer des préjugés communs. On ne peut mûrir à cette liberté que dans la liberté, assure-t-il. Cependant, il y a une place pour l’autorité éducative d’un maître. Chacun a besoin d’« un maître qui batte en brèche sa volonté particulière et le force à obéir à une volonté universellement valable, grâce à laquelle chacun puisse être libre. » Forcer chacun à être libre (sous la loi de la raison): voilà un paradoxe inquiétant qui porte la trace de Rousseau. Autre problème soulevé par Kant lui-même: ce maître est un homme, il a donc lui-même besoin d’un maître (Idée d’une histoire universelle, 6ème proposition).
Comment sortir de ces incohérences ? Pour Kant, penser par soi-même est un programme d’émancipation réalisable par chacun, car penser c’est exercer sa raison, faculté également partagée par tous, et c’est pourquoi, il faut sortir de ce piège de facilité et de lâcheté qui consiste à s’en remettre trop longtemps à d’autres : penser par soi-même donc, et n’avoir pour maître que sa raison propre-et-universelle.
En effet, la Raison est la capacité de s’élever à une loi universelle. En tant que, sur le plan moral, tu formules toi-même cette loi – sinon elle n’aurait pas de valeur morale mais seulement le pouvoir d’une contrainte sociale – elle signe ton autonomie (auto-nomos : capacité de se donner à soi-même une loi), c’est-à-dire ta liberté. Cette loi a la forme de toute loi, celle de l’universalité : agis de telle sorte que la maxime de ton action soit universalisable (qu’elle vaille également pour tous et pour chacun), qu’on peut formuler :agis de telle sorte que tu traites autrui comme une fin en soi (en tant que sujet d’une liberté) et jamais seulement comme un moyen (pour une fin quelconque). Ce qui exclut le meurtre, le vol, le mensonge, etc. Cet « impératif catégorique » te fait libre en tant que tu obéis à une loi que tu t’es toi-même prescrit, une loi qui te détache des contingences empiriques et de la contrainte des intérêts sensibles.
Le deviens ce que tu es convient parfaitement à l’éthique des Anciens, au projet d’une sagesse pratique conditionnée par la situation; avec Kant on passe à une morale du devoir inconditionné, celle de l’impératif catégorique. D’une subjectivité concrète soucieuse de la « vie bonne », on passe à une subjectivité formelle élevée à l’universalité des êtres raisonnables. Il y a un « devenir-universel ».
Deviens ce que tu es garde un sens avec Kant, puisque tu es porteur, comme tout autre, d’une raison que tu dois accomplir : ton destin moral est d’insérer l’universel de la loi dans la singularité de ton existence, ce que personne ne peut faire à ta place. D’un autre côté, deviens ce que tu es n’a pas grand sens, car tu es un être double, en conflit avec toi-même, entre la sensibilité (qui t’asservit) et la raison (qui te libère). La tâche de devenir un pur être de raison est inaccessible, et même absurde.
L’abstraction formaliste de Kant, qui a sa légitimité, rend difficile de déduire des obligations morales concrètes dans un contexte donné. Kant fait un devoir, pour chacun, de développer ses dons naturels, de travailler au bonheur d’autrui, d’œuvrer en faveur de l’établissement d’une République parfaite et d’une « Société des nations » (Idée d’une histoire universelle, 6ème proposition). C’est l’idée-fin d’un devenir-commun de l’humanité, qui, si éloigné et incertain qu’il soit, doit guider l’action de chacun.
7. Hegel et la dialectique du devenir
Hegel dialectise par le « travail du négatif » l’idée d’une histoire universelle de Kant. Il décrit une anthropogenèse: l’homme n’est homme que comme conscience de soi. Il a à le devenir, s’élevant au-dessus de la simple vie animale. Il ne peut le faire qu’en sortant de soi pour revenir à soi, il ne peut le faire que par la rencontre d’un autre. C’est la dialectique du désir qui est désir de reconnaissance par l’autre.
Hegel décrit cette rencontre comme un affrontement : chacun met en jeu sa vie, c’est le seul moyen d’établir qu’il est dégagé de l’animalité. Or, il se trouve que l’un des deux préfère garder sa vie en échange de sa servitude. Il y a donc un maître et un esclave. Mais la situation se renverse. Le maître n’a obtenu qu’une fausse reconnaissance puisqu’il est reconnu par une liberté supprimée. De plus, le maître est sous la dépendance du serviteur pour sa subsistance. Le serviteur, au contraire, par son travail, met sa marque sur l’objet qu’il façonne et peut se reconnaître ainsi dans l’objet: il réalise sa conscience de soi.
L’étape finale c’est la reconnaissance réciproque, la communauté des consciences de soi, dépassant la scission entre la vie singulière et la vérité universelle, dans un Nous que Hegel nomme l’Esprit: « un Moi qui est un Nous et un Nous qui est un Moi » dit-il dans une formule quelque peu mystique (Phénoménologie de l’Esprit, éd. Aubier. I p.154.). C’est en quelque sorte un devenir-commun incarné dans une communauté déterminée.
La dialectique du maître et de l’esclave articule la nature et la culture, le soi et l’autre, le désir et la mort, la jouissance et le travail, le pouvoir et l’aliénation. C’est un mythe rationnel, qui n’a pas de réalité proprement historique, mais seulement la valeur d’être une séquence de devenir qui est une matrice pour comprendre toutes sortes de situations humaines.
L’opérateur décisif qu’introduit Hegel est la négativité. Etre / Néant / Devenir. Etre est le concept le plus général qui soit, il est in-déterminé, vide, et par conséquent identique à sa négation, le Néant. Négation de la négation, nouvelle position enrichie des précédentes, advient le Devenir « qui en étant, n’est pas, et qui en n’étant pas, est »: il n’est pas encore ce qu’il est déjà, et déjà plus ce qu’il est encore, entre passé, présent et futur.
Deviens, donc, mais ce faisant tu dois te perdre en l’autre pour te retrouver en toi, tu dois devenir ce que tu n’es pas pour accéder à un Soi élevé à la valeur d’un Nous. Or, avec Hegel, le Devenir n’est que l’auto-développement de ce qui est donné dès le départ: l’Absolu se perd dans la Nature et se retrouve dans l’Esprit ; son terme achevé est l’Esprit se sachant lui-même: « L’Esprit se produit lui-même, il se fait lui-même ce qu’il est » (La Raison dans l’histoire). L’Esprit devient ce qu’il est.
Ce qui vaut à l’échelle de l’Esprit du monde, vaut aussi à celui de la singularité du héros tragique : « La force des grands caractères consiste précisément en ce qu’ils ne choisissent pas, mais sont d’emblée et depuis toujours ce qu’ils veulent et accomplissent. Ils sont ce qu’ils sont » (Esthétique, IV, 282-283 1835.)
Le devenir développe l’intégralité des virtualités de l’Etre (forme vide) pour aboutir à l’Esprit absolu (réalité achevée, en soi et pour soi) et c’est Hegel qui en est le penseur. Hegel s’achève sur la fermeture du Système, la clôture du Devenir. La vérité est circulaire, elle « a pour commencement sa fin comme son but ». Transposé à l’échelle du Soi individuel, on est revenu au deviens ce que tu es.
Or, le devenir insiste, l’Histoire n’est pas finie, ni sous les espèces du libéralisme politique et économique, façon Hegel, ni sous celle d’un « règne de la liberté » façon communisme de Marx : elle continue de bégayer. Quant au Soi, il entreprend toujours pour lui-même une nouvelle aventure.
8. Nietzsche. Deviens celui que tu es
Il y a bien une dizaine d’occurrences de la maxime dans l’oeuvre de Nietzsche. Il est difficile d’en faire une interprétation unique chez celui qui pratique une pensée fragmentaire exprimée dans des aphorismes et rejette toute construction systématique, à l’opposé de Hegel donc. On trouvera un tableau des différentes interprétations possibles dans l’article consacré à Nietzsche. Je résume ici l’une d’entre elles.
Nos pensées et nos actions sont l’expression – ou le symptôme – de forces inconscientes qui s’affrontent en nous : forces actives ou réactives, forces affirmatives ou négatrices, Nietzsche les appelle des « instincts » non pour en faire des pulsions figées, mais pour en accentuer le caractère inconscient: nous ne voulons pas, c’est quelque chose qui veut en nous. Chaque situation voit s’exprimer une certaine configuration de ces forces où l’une vient à l’emporter sur les autres et qu’on appelle alors une volonté. Ceci vaut aussi bien au niveau des individualités qu’à celui des « formations de souveraineté » propres aux sociétés humaines.
Nietzsche procède à l’analyse « généalogique » de ces configurations. Il les interprète, c’est-à-dire qu’il dévoile la force qui est à l’oeuvre dans tel ou tel type humain (par exemple le prêtre, le guerrier, le savant, l’artiste), et les évalue, selon le critère de l’intensité vitale qui s’y exprime : est bien ce qui conduit à un accroissement de la vie. Ce qui produit le maximum d’accroissement ce sont les forces actives-affirmatives.
Cet accroissement s’exprime dans des individus rares. Dans les foules humaines, ce qui domine ce sont les forces réactives et négatrices, le ressentiment contre les hommes forts, la négation de la vie, un idéal de médiocrité et de soumission qui est encouragé par les prêtres. L’homme fort de la « volonté de puissance » (qui n’est pas la volonté du pouvoir, souvent vulgaire, pas non plus le militarisme impérial, honni par Nietzsche, mais plutôt quelque chose comme la puissance de la volonté), cet homme fort est menacé dans son envol par le vouloir réactif des faibles.
Deviens celui que tu es s’adresse donc à cet homme qui sort du lot, se libère de tout le fatras moralisant de l’amour universel, et donne libre cours à son vouloir. Impitoyable pour lui-même et pour les autres, il est suprêmement égoïste et tout autant suprêmement généreux : il dilapide toute l’énergie débordante qui l’anime. Nietzsche pense principalement à l’aristocratie des créateurs, aux artistes qui inscrivent une forme dans le chaos : c’est l’art qui donne sens à la vie et nous console du tragique de l’existence.
A l’Etre stable des anciens métaphysiciens, comme à l’idée d’un progrès dans l’histoire, propre aux philosophes des Lumières, Nietzsche a substitué l’idée d’un devenir, succession de moments culminants, comme en ont connus, dans leurs configurations propres, l’antiquité grecque et la Renaissance. A nouveau, une possibilité s’ouvre, nous dit-il. L’homme est une flèche, l’homme est un pont – en route vers le surhomme – vers un homme à venir qui procèdera à de nouvelles évaluations. Cet homme qui surpassera l’homme est un heureux hasard qui surgira dans le contexte d’une nouvelle civilisation européenne.
Ce deviens ce que tu es peut donc s’interpréter comme un devenir-autre, comme un deviens ce que tu n’es pas, quoique Nietzsche n’utilise pas cette formule. Dans tous les cas, la maxime s’adresse à un être d’exception, un « esprit libre », un créateur solitaire qui se tient « à distance » de la multitude.
Le collectif, le commun, sont méprisés : « Et comment pourrait-il y avoir un « bien commun » ? Le mot renferme une contradiction. Ce qui peut être mis en commun n’a jamais que peu de valeur » (Par delà le bien et le mal §43). Nietzsche assimile la révolte des Communards à celle d’une « classe barbare d’esclaves ». La foule est toujours animée par le ressentiment vis-à-vis ce qui la dépasse, négatrice du libre épanouissement de la vie. Le Temps des cerises, comme négation de la vie ? C’est Nietzsche qui est dépassé par tout ce qui ressemble à une espérance révolutionnaire ! Il est nostalgique du « féodal », rêvant à « l’élevage d’une caste nouvelle dirigeant l’Europe » comme terreau pour l’éclosion des esprits libres et des créateurs. Il est à l’opposé de l’universalisme de Kant et de la synthèse de Hegel (deux auteurs qui ont admiré la Révolution française), tout comme du projet communiste de Marx.
9. Freud-Lacan. Qu’advienne le sujet ?
Freud, sous bien des aspects, n’est pas loin de Nietzsche: il y a des pulsions et des représentations dont l’accès à la conscience est barré mais qui ne sont pas sans effets sur la scène de notre vie sociale.
« Wo Es war soll Ich werden » prescrivait Sigmund Freud (Nouvelles conférences). Traduction littérale: « Là ou le ça était, doit devenir le Moi ». L’interprétation qui a prospéré dans le monde anglo-saxon, sous la dénomination de l’ « Ego-psychologie », fait de cette formule l’expression d’un conflit entre le « ça », réservoir des pulsions, régi par le principe du plaisir, le « Moi », ordonné par le principe de réalité, et le « Surmoi », juge et censeur – le premier inconscient, les deux autres en partie conscients, en partie inconscients. Le but visé est alors de renforcer le Moi pour canaliser le ça, réduire l’emprise du Surmoi et adapter la personne au monde social : « le moi doit déloger le ça ».
Loin de cette interprétation réductrice, Jacques Lacan retraduit la formule ainsi: « Là où c’était, le sujet doit advenir » (Les quatre concepts Chap.IV). En place du ça (c’), produire l’avènement du sujet, plutôt que du Moi, qu’est-ce à dire ?
Il y a deux scènes, l’une où le langage est réglé par les cadres sociaux ; l’autre où le langage fonctionne comme une chaîne de signifiants. Sur la scène sociale règne le sujet au sens ordinaire du terme, le Moi qui se croit maître dans sa maison ; sur l’autre scène règne le « sujet de l’inconscient » dominé compulsivement par des signifiants primordiaux (à commencer par le signifiant « phallique »), des signifiants inaccessibles qui interfèrent parfois dans les failles du discours ou de l’action, par exemple sous la forme d’un lapsus.
Quel est l’effet de la cure psychanalytique ? Le sujet (c’est quand même bien le même qui traverse les deux scènes) réalise l’assomption de son désir et gagne une fluidification de la chaîne des signifiants au lieu d’être asservi par eux dans la souffrance.
Au final, le sujet accepte son assujettissement au langage, le langage étant ce qui le sépare du réel. Il accepte une « vérité insupportable » qui lui permet d’avancer au lieu de rester fixé dans la répétition stérile de son symptôme. « La psychanalyse peut accompagner le patient jusqu’à la limite extatique du « Tu es cela », où se révèle à lui le chiffre de sa destinée mortelle mais il n’est pas en notre seul pouvoir de praticien de l’amener à ce moment où commence le véritable voyage » nous dit Lacan (Ecrits p.100). Et J.-B. Pontalis précise : « En analyse, il ne s’agit jamais de revenir à l’état antérieur mais de favoriser la venue d’un autre état qui n’a jamais été le vôtre » (Télérama n° du 24-3-1999). C’est une perspective existentielle plus que médicale.
Quoi qu’il en soit, deviens ce que tu es n’a pas de sens: le sujet est clivé par les oppositions: ça/moi, soi/image de soi, conscient/inconscient, sujet/Autre, aliéné au signifiant par le langage. Il est structurellement divisé, et, dès la parturition, marqué par un manque ou une perte, cause du désir. Le Moi des identifications et des masques sociaux n’est pas une donnée qu’il faudrait réaliser. C’est le sujet (plutôt que le Moi) qui se construit à partir de la conscience de ses déterminations inconscientes. Il sait qu’il ne sait pas, il connaît sa méconnaissance, il se sait clivé par l’Autre qu’il n’a pas créé: les autres (ordre de l’imaginaire), l’Autre du langage et de la culture (ordre du symbolique).
C’est donc finalement à la fois un deviens ce que tu es, puisque cette chaîne de signifiants qui t’habite tu n’en disposes pas à ta guise – et un deviens ce que tu n’es pas, puisque s’ouvre devant toi le véritable voyage : ce que tu feras de ton existence singulière, qui n’est pas défini à l’avance. Mais de cela la psychanalyse n’a pas la clé, juste le moyen d’en déblayer la voie.
10. Beauvoir-Sartre. Deviens ce que tu n’es pas ?
L’inconscient n’est pour Sartre qu’une conscience de mauvaise foi qui refuse de reconnaître son propre pouvoir: l’homme n’est pas déterminé par son passé mais placé en face de choix dans des situations qu’il n’a pas choisies. Il est l’être qui se fait être, assumant cette responsabilité ou la contournant avec mauvaise foi.
Dans cette perspective, Simone de Beauvoir initie une réflexion sur le genre dans Le Deuxième sexe (1949): « on ne naît pas femme, on le devient », on n’est pas femme, on le devient. Une femme naît biologiquement femme, mais elle ne naît pas subordonnée à l’homme, elle le devient, en tant que la femme se définit, dans les sociétés patriarcales, par des stéréotypes: infériorité, soumission, séduction, oblation, etc. Ces stéréotypes de la « féminité » ne sont pas fondés en nature, ils sont culturellement déterminés. Pendant des siècles, privées de liberté, les femmes n’ont pu s’accomplir, sauf exception, pour devenir autre chose que ce à quoi les assignait leur statut.
Là où la société a évolué, là où elles ont conquis des droits, les femmes ne sont plus l’autre aliéné de l’homme, elles sont devenues femmes en tant que sujets émancipés. Elles s’inventent femmes par l’exercice de leur liberté, dans une situation historique qui le permet. Il n’y a pas, tout autant, d’essence de l’éternel masculin: on ne naît pas homme, on le devient.
Cette thèse, initiatrice des « études du genre », est cohérente avec l’ontologie existentielle exposée par Jean-Paul Sartre dans L’être et le néant (1943). Selon Sartre, y a deux modes d’être : l’« être-en-soi » des choses, l’« être-pour-soi » de l’homme comme conscience de soi. Les choses ne sont que ce qu’elles sont ; l’homme n’est pas ce qu’il est, il existe (ex-sister : être à distance de soi), il n’est pas, il a à être.
Le pour-soi, c’est le néant introduit dans l’être-en-soi : fissure, faille, manque par où arrive la conscience et la liberté. Aussi l’homme est-il l’être qui est ce qu’il n’est pas et n’est pas ce qu’il est (L’être et le néant p.711): caractéristique du devenir, reprise à Hegel. L’homme est toujours en avance sur soi, il se pro-jette vers un à-venir qui donne sens en retour à son passé. Il y a ouverture des possibles dans une faille entre passé et futur où peut advenir du neuf. Cette « néantisation » qui fait décrocher du pur être-en-soi coïncide avec la liberté comme auto-production : c’est pourquoi, lorsqu’il s’agit de l’homme, « l’existence précède et commande l’essence. »
De par cette structure du pour-soi, l’homme est « condamné à être libre ». Et même : « Jamais nous n’avons été plus libres que sous l’occupation allemande » (Situations III), car si nous ne sommes pas responsables de la situation dans laquelle nous sommes jetés, nous sommes responsables de ce que nous faisons de cette situation. Du coup, chacun « porte le poids du monde entier sur ses épaules » (L’être et le néant p. 639) : chacun propose une image de l’homme aux autres, libre à eux de la reprendre ou non.
Qu’est devenue notre maxime ? Il faut répondre à la place de Sartre. Le prescriptif deviens ce que tu es n’a pas de sens, puisque tu es un devenir. Devenir soi est impossible, puisqu’il n’y a pas de « soi » arrêté. Le descriptif : « deviens ce que tu deviens » convient, qu’on peut reformuler, pour éviter la tautologie : « Deviens ce que tu n’es pas », deviens autre chose que ce que les déterminations veulent te faire être (par exemple, deviens résistant alors que tu es situé dans un milieu collabo), assume ta liberté, une liberté constamment menacée par l’engluement dans la mauvaise foi. Une « mauvaise foi » qui consiste à occulter ton angoissante liberté, en t’identifiant au rôle que tu joues et aux codes que tu répètes, dans le rêve illusoire de coïncider avec toi, à la manière d’une chose, comme si ce n’était pas toi qui avais fait le choix de te couler dans ce rôle et d’obéir à ces codes.
L’ « existentialisme » de Jean-Paul Sartre reprend la négativité de la dialectique hégélienne, sans la synthèse, sans l’absorption du « néant » dans un « être » final. C’est une philosophie de l’absolue liberté de l’homme en situation, à l’extrême opposé du fatum nietzschéen.
Même s’il décrit un « être-avec » comme structure du pour-soi, l’autre est relativement absent de L’être et le néant, il apparaît plutôt comme un intrus qui « me vole mon monde » et tente de me réifier. Sartre a renoncé à publier sa « morale » (Cahiers pour une morale, écrit posthume) et sa « politique » a eu peu d’effets (Critique de la raison dialectique). Mais du moins n’est-il pas resté retranché dans sa philosophie, il a pris le risque de « devenir » à travers les tentatives contrastées de ses engagements politiques.
11. Deleuze-Guattari. Devenir-autre
Dans une perspective nietzschéenne, en rupture avec le triangle de l’Œdipe freudien et loin de l’ontologie sartrienne, Gilles Deleuze et Félix Guattari (Mille plateaux, dans le chapitre: Devenir-intense, devenir-animal, devenir-imperceptible) décrivent les virtualités du devenir, ces modifications « imperceptibles » qui nous transforment en autre chose que nous-mêmes: par exemple un devenir-femme, un devenir-enfant ou un devenir animal.
Soit Moby Dick, le roman de Herman Melville. On y découvre le devenir-animal du capitaine Achab, entraînant ses matelots à la poursuite de la baleine blanche, en bordure du banc des cachalots, sur le plan lisse – sans route maritime balisée – de l’océan, tandis que la baleine elle-même est en train de devenir autre chose, une Chose absolue qui a noué une alliance fatale avec le capitaine après avoir cannibalisé sa jambe. Tour à tour lenteur et vitesse des déplacements : ici, longue attente, et là, le harpon qui jaillit et le coup de queue en retour. Intensité des affects entre respect et imprécation d’Achab à l’adresse de la baleine. Il ne s’agit pas d’une identification entre l’homme et l’animal: les termes sont hétérogènes, le rapport est asymétrique, mais peut-être que, lorsque Achab est pris dans un rapport de vitesse et de lenteur correspondant à celui de la baleine, il a des affects de baleine – et inversement. C’est une zone de voisinage qui échappe à ces coordonnées habituelles qui font du chasseur et de sa proie des étrangers l’un à l’autre et qui « territorialisent » une campagne de pêche avec pour cible la meute des baleines et non le défi d’une unique baleine. D’un côté, on cherche n’importe quelle baleine à portée de harpon, de l’autre on est lancé sur un ligne de fuite avec une baleine singulière.
Délaissant les formes et les sujets, les choses et les vivants, identifiés comme des individualités, et qui sont le lot le plus évident de nos occupations, Deleuze et Guattari explorent les multiplicités qui nous constituent, en marge du « plan d’organisation » fonctionnel de notre corps. Voilà que des parties de notre corps se connectent à un dehors, à des parties d’autres corps, dans un agencement particulier, sur des « lignes de fuite » qui tracent un « plan d’immanence ou de composition ». Ce plan est immanent parce qu’il ne préexiste pas, il se découvre en même temps qu’il se déploie, hors des sentiers battus, et n’est pas l’expression d’un plan d’organisation préétabli, ni la création d’un sujet dominateur. Là s’accomplissent des devenirs « minoritaires », car ils n’engagent pas toute notre individualité, ils opèrent selon des connexions locales et temporaires qui constituent des individuations, nommées par Deleuze-Guattari « eccéités » : tel ceci ou tel cela qui ne se produit qu’une fois (tout en s’inscrivant dans une série.) Ainsi nous ne sommes pas (seulement) un individu déterminé – une personne – mais de multiples agencements désirants traversés de flux multiples.
Par exemple, tel cinq heures du soir au pied d’un rocher face à un lac ; telle rencontre entre deux écrivains qui produisent momentanément un nouveau sujet bicéphale ; telle poursuite nomade, des années durant, entre le chasseur et sa proie. On pourrait les appeler aussi des évènements. Ce sont des devenirs. Un devenir, c’est le passage d’une frontière, la poussée hors des limites instituées, une « déterritorialisation » qui fait sortir du plan d’organisation dominant (existence sociale, règles d’un métier, institutions familiales ou appareil d’Etat). C’est un évènement qui nous arrive et qui se comprend sous deux dimensions : la dimension extensive, faite de mouvement et de repos, de degrés de vitesse et de lenteur (le calme plat sur l’océan et la tempête, l’attente et le combat) ; la dimension intensive avec ses affects actifs et passifs (la souffrance reçue ou infligée et leur dimension mystique).
Soit le devenir-femme et le devenir-homme. Dans la perspective de Deleuze et Guattari, il y a de multiples hommes et de multiples femmes virtuels en chacun de nous et qui peuvent entrer dans des rapports de production de désir multiples. On pourrait dire différemment, que s’il y a un devenir-femme, il n’y a pas de devenir-homme car le masculin est le plan d’organisation dominant – y échapper, c’est justement réaliser un devenir-femme.
Le devenir est doublement menacé: par l’emprise du plan d’organisation dominant qui cherche à le neutraliser, à le « reterritorialiser ». Il y a toujours oscillation entre les deux plans, le plan d’organisation et le plan d’immanence, l’un dur dont on ne peut se passer, l’autre souple qui est une aventure incertaine. Le devenir est menacé également par la mort, comme dans le désastre final de Moby Dick, lorsque l’intensité de ce qui arrive est en excès sur la puissance de celui qui l’éprouve ou se trouve trop loin du plan d’organisation. Mais le devenir peut, au contraire, affirmer la vie, comme dans la lutte d’un peuple opprimé, quitte à ce que la révolte finisse par se couler dans des institutions – dans une machine d’Etat.
Le concept de « meute » apparaît. La meute, c’est nous-mêmes, cette multiplicité ondoyante de devenirs qui nous animent lorsque nous ne sommes pas enfermés dans les coordonnées de notre existence. C’est bien sûr aussi l’équipage ou le banc des baleines, ou certaines configurations de peuples nomades, ou le réseau social. Le réseau social est l’expression contemporaine de ce que Deleuze et Guattari appellent un « rhizome » – cette prolifération chaotique de connexions -, qui peut servir de milieu à la révolte contre un régime oppressif (l’éphémère printemps arabe, par exemple) aussi bien qu’à la propagande terroriste (l’islamisme radical, par exemple). Réseau, rhizome : on retrouvera ces concepts lorsqu’il s’agira de faire fructifier dans notre enquête l’idée du « commun ». Néanmoins, si Deleuze et Guattari décryptent le capitalisme et ses formes de domination, ils ne thématisent pas le « commun » comme tel: c’est sans doute pour eux un concept trop territorial, trop commun.
Ainsi donc, quelque chose de sauvage et d’inédit nous emporte parfois, un devenir a-historique qui tient sa réalité de lui-même et dont la meilleure écriture est romanesque, pas biographique. La biographie découpe une vie en segments bien identifiés: tu es ceci ou cela, avec ce passé et ce futur ; le roman explore autre chose, les fêlures des devenirs-autres. Dans un devenir, le sujet et les formes s’effacent (c’est pour cela qu’on est dans « l’imperceptible »), reste le pur deviens où ce qui est recherché n’est pas le but, mais le devenir lui-même, un devenir-autre en perpétuelle modification qui se réalise par des « eccéités » obscures et fragiles.
12. Transhumanisme. Deviens illimité ?
Loin de Deleuze – mais peut-être pas si loin ? – le courant transhumaniste. Articulé au plan d’organisation des organes humains plutôt qu’à ces lignes de fuite deleuziennes qui tracent un plan imprévisible, il prône une amélioration de l’espèce humaine, l’augmentation de ses pouvoirs physiques et mentaux, l’accroissement de ses capacités biologiques par une victoire sur le vieillissement.
Dans sa version « scientiste », le transhumanisme met en scène la convergence des progrès récents des nanotechnologies (miniaturisation), des biotechnologies (génie génétique, clonage), des technologies de l’information (intelligence artificielle) et des sciences cognitives. Il en fait une projection futuriste : l’homme bionique, la symbiose entre l’humain et le robot, la perspective d’un humain transgénique chez qui la mutation programmée remplacerait la mutation darwinienne et la seule transformation culturelle. Le transhumanisme nous ferait basculer vers un nouvel âge « posthumain ». Au final, c’est même la victoire sur la mort et sur la violence qui est rêvée, ce qui ne serait rien de moins qu’une divinisation de cette post-humanité.
Quelques résultats spectaculaires sont déjà obtenus dans le domaine de la santé et du handicap – et, aussi bien, dans le domaine militaire ! Saisissant ce filon, le projet transhumaniste, né en Californie, est investi aujourd’hui par Google, ce qui conduit à s’interroger sérieusement sur la domination de la pensée « libérale » ou plus exactement « libertarienne », véhiculée par ce programme.
Les risques de ce devenir-autre radical ont de quoi inquiéter: une politique de l’espèce avec l’eugénisme, un partage inégal des nouvelles technologies qui conforterait la sécession des privilégiés, la possibilité de contrôler et d’asservir les hommes, l’oubli de la question écologique et de la question sociale. Il ne faut pas négliger non plus l’avertissement de Stephen Hawkins proféré à la BBC l’an dernier : « Je pense que le développement d’une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à la race humaine.» Les machines informatiques pourraient dominer nos existences, non pas comme un dictateur unique à la façon des films de fiction, mais comme un système de réseaux interconnectés qui fonctionnerait en échappant à notre contrôle.
En attendant, le gouffre se creuse entre les capacités techniques des humains et leurs capacités à s’épanouir individuellement et à coexister pacifiquement. Loin du rêve fou des transhumanistes, c’est de cela qu’il fait d’abord s’occuper, de ce devenir-commun qui inclut l’attention au devenir de la planète. Ce devenir-commun n’est pas l’ennemi d’une technique démocratisée. Il peut s’appuyer sur le développement des réseaux pour produire de nouvelles formes d’intelligence collective et d’innovation sociale.
Conclusion. Devenir soi, devenir autre, devenir commun
Devenir-soi. Deviens ce que tu peux être, si ton désir est là, non pas en tant qu’objet aux contours bien définis, mais en tant que sujet autonome vivant. Libère-toi de l’individualisme stéréotypé qui s’exténue dans l’avoir-toujours-plus de la consommation insatisfaite, dans le paraître-toujours-plus et la communication futile sur le réseau. Sors de la « servitude volontaire » a-politique à l’égard des nouveaux maîtres de ce monde, à l’égard de ce système global qui domine nos existences aussi bien dans ce que nous respirons ou mangeons que dans ce que nous divertit et s’insinue dans nos pensées. De sujet assujetti (sujet: sub-jectum, « jeté dessous », soumis à comme on parle des sujets du roi) deviens sujet émancipé (sujet: sub-jectum, « jeté dessous », support de), créateur d’un nouveau toi-même, producteur d’une nouvelle subjectivité. Prends ta vie en main, pour que ce ne soient pas d’autres qui s’en chargent à ta place. Fais acte de culture. C’est une conquête difficile et parfois risquée.
Deviens ce que tu es peut alors être interprété par une torsion comme: Tu seras ce que tu deviens. Car ce que tu es, on ne pourra le savoir que lorsque tu le seras devenu sans qu’aucun devenir supplémentaire ne puisse s’ajouter. On ne peut donc le dire qu’à la fin, lorsque l’aventure de ton existence entre naissance et mort sera terminée: alors en effet, tu seras ce que tu es (devenu).
Mais cette vérité est insaisissable, que ce soit par toi (tu ne seras plus là) ou par les autres qui n’en ont que des représentations partielles. Ta biographie ne peut s’exprimer que dans une narration qui est un arrangement, une sélection, un roman vrai et une erreur. Peut-être qu’on pourra dire de toi : tu as poursuivi toute ta vie le même but, mais les choses sont plus compliquées, et le digest de ta vie n’est qu’un reflet dérisoire de qui tu es (a été). Ton identité vécue ne peut être ramenée à l’unité, elle est intermittente, inquiète et travaillée par l’autre jusqu’en soi-même. « Je est un autre », disait Rimbaud , « un Je qui n’est pas un Moi » selon le mot de Proust.
Devenir-autre. Deviens ce que tu n’es pas. Eduque-toi, puisque s’é-duquer, c’est être conduit hors de soi. Mets-toi à la place d’un autre, pour en tirer profit. Accueille les virtualités qui reposent en toi pour en faire la création du neuf. Garde un sens lucide du tragique de l’existence, mais réfute le destin aveugle. Et sois à l’écoute de ce qui arrive d’imprévisible. Empare-toi de ce qui s’appelle tantôt le hasard ou la chance, tantôt l’opportun (le kairos des Grecs), ou encore l’occasion (Machiavel), l’évènement, la rencontre, « le vide de la situation » (Alain Badiou), quelque chose d’inattendu qui ouvre une bifurcation devant toi, celle du rester soi et celle du devenir autre (qui comporte toujours un moment de révolte contre la résignation),
Ce devenir-autre n’est pas l’enfermement dans un état d’aliénation mentale où le sujet est habité par un autre et délire sous les injonctions d’une voix qui lui parle, aliénation dont une variante est l’incorporation dans une secte. Ce n’est pas plus l’arrêt sur une identité unique qui fige toute la personnalité, et pas non plus la dissolution dans n’importe quelle identité offerte à la consommation, mais une construction de soi, à partir de plusieurs identités héritées et rencontrées, dans un métissage dynamique. Par exemple ce fils d’agriculteur devenu écrivain, ou ce chercheur établi comme néo-paysan. Ces basculements peuvent être d’abord souterrains, imperceptibles, ou au contraire soudains, successifs à une rencontre. On assiste parfois à de surprenantes conversions, à des engagements inattendus.
Or, tu deviens ce que tu n’es pas à partir de ce que tu es. Cet « autre-que-toi », c’est encore toi, à la fois ce que tu es (l’ancien toi-même) et ce que tu n’es pas tout en l’étant déjà (le nouveau toi-même), l’un s’appuyant sur l’autre. C’est un-même-et-un-autre en construction. Ne démissionne pas, mais ne rêve pas non plus de pureté : le sujet qui en sortira sera nécessairement un sujet hybride, métissé, compliqué.
Devenir-commun. Mais surtout ce devenir ne peut être une entreprise solitaire. Il lui manque la dimension du Nous et le pari du devenir-commun. En effet, pas de Soi sans autrui, cet autre Soi irréductible au tien. Pas de Soi sans l’inscription dans un langage et une culture que tu reçois sans les avoir créés. Cet « Autre » qui t’accueille quand tu viens au monde, il te précède, tu as une dette à son égard, et c’est même cela qui est au fondement d’une éthique laïque, indépendante de toute religion. Il faut nécessairement introduire cette dimension éthique pour évaluer les devenirs au sein des communautés humaines, sauf à justifier tout et n’importe quoi, y compris le monstrueux.
Sur fond de cette dépendance à l’Autre, à toi d’apporter ta pierre, de devenir un co-producteur du langage et de la culture et d’accueillir dans le monde, à leur tour, des « nouveaux ».
Devenons ce que nous sommes, par conséquent, ou mieux ce que nous ne sommes pas, dans un devenir-commun qui reste à définir, producteur d’un « sujet collectif ». C’est le devenir-nous de la coopération dans une oeuvre ou de la solidarité dans l’action. Ce n’est pas la simple liberté négative de la Déclaration des droits de l’homme, qui définit l’autre comme la limite à ma liberté, mais c’est au contraire une liberté positive où l’autre, inscrit dans un « nous », est le support et la condition de ma liberté et de l’accroissement du champ de mes possibles.
Hormis le « nous » des amoureux, traditionnellement arrêté au deux, le « nous » est en principe un chiffre ouvert, tel qu’il est compatible avec une entreprise collective (un groupe d’amis, une association locale, un syndicat, etc., constitués en fonction de tel ou tel projet). Le « nous » qui inclut les différences individuelles s’oppose au « nous » sectaire du groupe fermé soumis à un leader ou à une idéologie. Ce dernier se présente comme communauté d’identité qui exclut le débat et la critique, et par conséquent se refuse à devenir. La vieille aporie de l’un et du multiple ressurgit ici : on dit un groupe, le multiple est un, mais tout change selon que ce multiple est celui de l’addition d’identités ou de la composition de différences.
Devenir-soi dans et vers un devenir-nous ; devenir-nous avec et pour un devenir-soi ; contre la dialectique hégélienne, la synthèse est disjonctive : les termes qui sont distingués (soi/autre, soi/commun) sont irréductibles et inséparables. Un devenir-soi solitaire est impossible ; un devenir-nous exclusif est aliénant ; isoler l’un de l’autre est mortifère pour le soi et pour le nous. Le devenir-commun doit inclure un devenir-soi à chaque fois singulier.
Cette possibilité, et même cette nécessité éthique et politique de s’élever à un devenir-commun articulé au devenir-soi, sera l’objet d’un article ultérieur : j’y évoquerai, appuyé sur différentes figures philosophiques, le « vivre-ensemble », le « singulier pluriel », le « commun », les notions de « multitude » et de « peuple » qui interrogent ce qu’on peut entendre par « démocratie », après le communisme, ou plus précisément après le « socialisme historique » et à l’âge où se conjuguent la mondialisation libérale et la menace globale sur notre planète.
Crédit Jacques Darriulat présente sur son blog un inventaire et une analyse des principales occurrences de la maxime depuis Pindare jusqu’à Camus. Je lui dois plusieurs citations, utilisées ici librement.