Vous connaissez l’économiste Thomas Piketty, spécialiste de l’histoire des inégalités sociales, et, c’est son apport le plus original, des inégalités de patrimoine. Il a publié une première grande enquête en 2013 avec Le Capital au XXI° siècle (2013), prolongée en 2019 par Capital et idéologie (2019). Ce qui suit constitue une exploration de Capital et idéologie, ce livre touffu de 1200 pages. Une exploration libre et parfois présomptueusement critique venant d’un béotien. Lecture complétée par celle de quelques articles récents de sa plume, et additionnée de digressions de ma part. La frontière entre le propos de l’un, Piketty, et le commentaire de l’autre, votre serviteur, n’a pas toujours été facile à tracer. Qu’on m’en excuse.
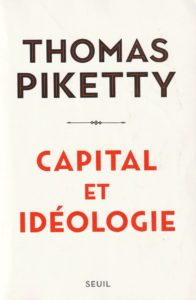 L’objet de Capital et idéologie consiste en un diagnostic suivi d’une thérapeutique : un versant descriptif et un autre prescriptif. Piketty est un économiste engagé.
L’objet de Capital et idéologie consiste en un diagnostic suivi d’une thérapeutique : un versant descriptif et un autre prescriptif. Piketty est un économiste engagé.
Le diagnostic consiste en une étude comparative des régimes socio-économiques et des idéologies relatives aux inégalités dans le monde occidental développé depuis le 19ème siècle.
La médication ne vise pas à « guérir » le capitalisme de ses maux inégalitaires, mais carrément à le « dépasser » vers un nouvel état de santé.
Par quel moyen ? Par un « socialisme participatif et fédéraliste » susceptible de rassembler une « nouvelle coalition égalitaire » agissant à l’échelle internationale. Les points d’application de ce dépassement concernent le régime de propriété, le système éducatif, l’exercice du pouvoir économique. Un bouleversement fiscal radical en constitue l’élément décisif, qui doit aboutir à un écrasement de l’échelle des revenus et à une déconcentration de la propriété.
A l’heure où le sport le plus populaire consiste à vilipender les impôts, voilà quelqu’un qui, à contre-courant, célèbre l’impôt et jongle avec la fiscalité comme si la fée de Bercy s’était penchée sur son berceau.
I. Qu’est-ce qu’une inégalité juste ?
La question, apparemment glaçante, est explicitement posée par Piketty, dans la ligne de la Théorie de la justice (1971) du philosophe américain John Rawls. N’est-ce pas contradictoire d’accoupler un principe d’égalité, la justice, avec un état d’inégalité ? N’est-ce pas un mauvais départ que de viser de « justes inégalités » plutôt qu’une « société des égaux » ? Il ne s’agit pas pour autant de choisir le nivellement égalitariste, ce qui serait encore une forme d’inégalité, puisque les besoins, les situations, les projets de vie de chacun sont multiples et variés.
Admettons le présupposé : les inégalités sociales peuvent être « justes », non pas « justes en soi », mais « acceptables par tous » dans un contexte donné, et il s’agit seulement de trouver comment les définir. Ces inégalités ne posent pas de problème si elles sont justifiées en étant « fondées sur l’utilité commune », nous dit Piketty, qui rappelle l’article 1 de la Déclaration de 1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune », article qui, notons-le, parle de « distinctions sociales » et non d’inégalités, traite des droits et non des richesses.
L’égalité en droits étant admise comme socle inaliénable, reste en débat la question des inégalités de fait, les inégalités économiques, socialement construites. Celles qui nous font dire, par exemple, qu’à travail égal, salaire égal, mais qu’à travail de qualification différente, le salaire doit être différent.
Digression sur l’échelle des rémunérations
Mais comment donc déterminer cette juste inégalité de salaire ? Piketty n’engage pas ce débat. Faut-il faire la différence entre le « travail simple » (le manœuvre qui pousse sa brouette) et le « travail complexe » (l’ingénieur qui résout une équation) ? On retrouverait sous l’inégalité, l’égalité de proportions :
travail simple / salaire de base = multiple du travail simple / multiple du salaire de base
Cette justice distributive a pour nom « équité ». Soit, mais selon quelle mesure calculer la « complexité » d’un travail par rapport à un autre ? La « valeur de la force de travail » n’est pas quelque chose de calculable in abstracto, mais une réalité historique. On peut faire référence au coût et à la durée des études pour parvenir à un certain niveau de qualification : aux Etats-Unis, les étudiants s’endettent lourdement, mais en France par exemple, une bonne partie de ce coût est mutualisé. Notons que si la « juste inégalité » de salaire tient aux frais de qualification, cela justifie au plus un écart de salaire du simple au double. On est loin de ce compte.
Le rapport de force
En dehors des fluctuations de l’offre et de la demande sur le marché du travail, il ne reste qu’un rapport de force, le combat des salariés pour s’approprier une plus ou moins grande partie de la valeur ajoutée. Ce pourquoi, aujourd’hui, avec la relative atonie des luttes sociales et la domination idéologique libérale, les dirigeants peuvent s’approprier des rémunérations pharamineuses. Joue également la représentation qu’on se fait des bénéficiaires : on accepte des rémunérations indécentes pour les footballeurs (Messi a reçu l’équivalent de 4000 SMIC annuels en 2020), tout en se scandalisant des petits salaires des aides-soignantes…
L’échelle des salaires était de 1 à 10 dans les années 1950, de 1 à 500 dans les années 2000. L’écart est abyssal avec les patron les mieux payés : en 2020, l’inventif Elon Musk, a touché (en stocks options) quelques 600 millions $, l’équivalent de 33 000 SMIC annuels français. Aucune justification à cette explosion de l’échelle des revenus, et certainement pas le risque assumé : le salarié licencié écope d’une maigre indemnité tandis que le PDG accueille une indemnité de départ obèse.
Faut-il indexer le salaire sur l’utilité du travail ? Or, dans l’idéologie libérale, la rémunération des actionnaires et des dirigeants et le « ruissellement » censé s’ensuivre, relèvent de l’utilité commune ! Plus sérieusement, la question de l’utilité sociale est réapparue à l’occasion de la crise sanitaire : comparez une infirmière qui administre une potion et un trader qui jongle avec les actions de la Big pharma… Comme le note malicieusement l’anthropologue David Graeber, analysant les Bullshit Jobs, « on observe une relation inverse entre la valeur sociale d’un emploi et la rémunération que l’on en tire ». Mais une fois qu’on a dit ça, on est pour autant incapable de fixer une mesure « objectivement calculable » d’un « juste salaire », on a juste un vague sentiment de ce qui est équitable ou ne l’est pas et il reste la réalité du rapport de force employeurs /employés. [1]
Notons que la question du revenu des actifs non-salariés, rémunérés au bénéfice, aux honoraires, à la commission, au cachet, etc., nous emmènerait encore ailleurs.
II. Petite histoire de la propriété et de ses idéologies
Revenons à Piketty. Il définit le capitalisme comme « propriétarisme » plutôt que comme « libéralisme ». Sans doute pour éviter la confusion libéralisme économique / libéralisme politique, mais aussi et surtout parce qu’il met la question de la propriété privée au cœur de son analyse du capital.
Il étudie d’abord les sociétés « trifonctionnelles » anciennes dont il affirme le caractère quasi universel. L’« Ancien régime » en est un exemple, avec ses trois ordres (clergé, noblesse, Tiers-Etat). Le clergé, maître des âmes, et la noblesse, maîtresse des corps, répondent aux deux besoins fondamentaux de sens (la religion) et de sécurité (la force armée), l’un devant produire du consentement, quand l’autre brandit la menace de la contrainte. Ces deux ordres conjoignent le pouvoir sur les hommes (politique) et le pouvoir sur les choses (propriété) : les nantis du clergé et de la noblesse, soit 1% de la population, possédent alors 50% de la propriété foncière, tandis que 50% de la population ne posséde rien.
Le Nouveau régime, issu de la Révolution, tente de redéfinir ces rapports de pouvoir et de propriété. Il les disjoint en les rendant accessibles, en principe, à tous : la propriété par l’acquisition privée, les pouvoirs régaliens par la représentation nationale. La nuit du 4 août sont abolis, nous dit-on, les privilèges, mais pas tous et pas tous sans compensation, et surtout, il n’y a pas de redistribution de la terre à ceux qui la cultivent. Les révolutionnaires, en tout cas ceux qui ont initié et conclu la Révolution, ne veulent pas de mesures radicales contre la propriété qui menaceraient leur propre patrimoine et, disent-ils, conduiraient au chaos. La propriété est donc définie, au même titre que la liberté et l’égalité, comme un droit naturel, inviolable et sacré (article 1 de la Déclaration 1789, avec la réserve de l’article 17 qui admet la préemption en cas de « nécessité publique », mais sous condition d’« une juste indemnité »). [2]
Les statuts sont effacés, il ne reste que des citoyens égaux en droits, et des contrats « librement » consentis. Chacun doit pouvoir s’épanouir – et devenir propriétaire, ce qui en est la consécration – sans se heurter à la barrière d’un état lié à sa naissance. Les anciennes fonctions des deux premiers ordres (l’éducation, la protection) ont vocation à devenir le monopole de l’Etat, un Etat de plus en plus centralisé, qui a pour rôle de garantir l’égalité des droits et de protéger le droit de propriété.
Il le fait si bien qu’en 1900-1910, à la « Belle Epoque », la concentration de la propriété est pire que sous l’Ancien régime : les 1% les plus riches possèdent 60% du patrimoine. 1789 est in fine une révolution « bourgeoise » et le 19ème siècle conforte le sacre de la propriété, l’accompagnant d’une politique de stabilité monétaire, en vue d’éviter toute inflation qui dévaloriserait le patrimoine acquis. La confusion du rapport de propriété et du rapport de pouvoir revient en force avec les régimes censitaires qui dominent en France jusqu’en 1848. Même lorsque le suffrage universel masculin s’installe, les Assemblées élues voient la domination des notables, donnant une image déformée de la Nation dont on n’est pas sorti.
L’esclave comme propriété
La prégnance de l’idéologie propriétariste apparaît en toute clarté dans le processus d’abolition de l’esclavage qui s’impose au début de 19ème siècle dans l’aire occidentale. Le système productif esclavagiste a atteint ses limites et les révoltes d’esclaves, de plus en plus significatives, font peur.
La question de la compensation se pose alors. Mais une compensation pour qui ? Pour les esclaves ? Pas du tout : pour les propriétaires d’esclaves ! Et qui va payer ? Soit le contribuable des métropoles, soit les esclaves eux-mêmes. Très peu considèrent que ce sont ces derniers qui doivent être indemnisés : Condorcet est de ceux-là ; Schoelcher aussi, avant d’y renoncer.
C’est l’apothéose cynique du propriétarisme. En effet, le droit oblige à une compensation versée à celui qu’on dépossède d’un bien « légalement » acquis, tel l’esclave, ce « bien meuble » disait le Code Noir. Dans cette affaire, le propriétaire est réputé perdant, tandis que l’esclave est le gagnant, qui se libère d’un lien de dépendance. Le point de vue de la propriété prévaut d’ailleurs sur le point de vue racial, puisque les affranchis propriétaires d’esclaves sont eux aussi indemnisés.
Ces compensations sont à l’origine de grandes fortunes en France et au Royaume-Uni : la « Grande divergence » entre l’Occident et le reste du monde, caractérisée par la Révolution industrielle, repose pour une part sur l’exploitation esclavagiste issue de la traite et sur les indemnités de l’affranchissement. Quant aux affranchis eux-mêmes, sauf exception, il ne leur reste guère que leur chemise : pas de redistribution des terres, la loi réprime le « vagabondage » et la mendicité, le travail forcé réapparaît, l’affranchi pauvre reste un sous-citoyen. [3]
Notons, pour notre part, que la colonisation, particulièrement sur le continent africain, prend le relais, réalisant, selon le mot de Kofi Yamgnane, un « esclavage sur place ». Travail forcé et enrôlement forcé y constituent en effet un néo-esclavage, à quoi s’ajoute l’accaparement massif des terres indigènes, à rebours du discours d’égalité des « civilisateurs ».
La propriété en crise
Après la 1ère Guerre mondiale et la révolution bolchevique, et surtout après la Grande Dépression et la 2ème Guerre mondiale, les pays capitalistes deviennent « sociaux-démocrates » pour endiguer l’alternative « communiste ». La forme classique de la « société des propriétaires » disparaît. Des nationalisations ont lieu. Vers 1980, les 1% les plus riches ne détiennent plus que… 25% du patrimoine.
Puis, avec le tournant ultralibéral des années 1980, la concentration de la propriété reprend, mais encore loin des taux de la Belle Epoque. Aujourd’hui, en France, les 10% les plus riches possèdent 55% du patrimoine total, tandis que les 50% des ménages du bas de l’échelle n’en possèdent que 5%. Dans le monde occidental, les grosses fortunes ont progressé 4 fois plus vite que la croissance mondiale, l’essentiel de la valeur ajoutée étant captée par les plus riches (27% est allée au centile supérieur), la pauvreté officielle régresse légèrement (avec des oscillations au gré des crises), les classes moyennes stagnent.
Méritocratie
Dans la société de propriétaires du début du 19ème siècle, telle que décrite par Balzac, l’absence de relation entre le patrimoine possédé et les capacités personnelles est cyniquement assumée : chacun joue le rôle assuré par son capital, non par son mérite. Les choses changent avec deux grandes époques qui ont des points communs : financiarisation et mondialisation de l’économie d’une part, extrêmes inégalités de l’autre. Il s’agit de la Belle Epoque (1880-1914) et de l’hyper libéralisme actuel (1980 à nos jours).
Le capitalisme a toujours besoin de se trouver une justification. Il le fait alors au moyen d’un discours méritocratique. D’un côté sont célébrés les « gagnants », identifiés aux plus méritants, ceux qui « ont bossé dur pour en arriver là », et de l’autre sont dénigrés les « perdants », qu’on affirme responsables de leur sort. Et, en plus, il faut le leur faire comprendre, par exemple, en disant, à l’instar d’Emmanuel Macron, qu’une gare « c’est un lieu où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien ». A quoi s’ajoute l’idéologie du « ruissellement » qui fait que ceux d’en bas devraient remercier ceux d’en haut !
Digression. Le jeune migrant et le fils de patron du CAC 40
Cette arrogante méritocratie, parfois euphémisée en « élitisme républicain », est une supercherie, de même que la prétendue « égalité des chances ». Les « gagnants » (en fric et en notoriété) sont largement des « héritiers », héritiers d’un capital monétaire et d’un capital culturel inégalement répartis. Or, il n’y a pas de mérite à être un héritier. Pour le dire en un raccourci, le jeune migrant qui devient boulanger a plus de mérite que le fils de patron qui devient DRH, alors que leurs salaires vont du simple au décuple.
Il n’y a pas de mesure calculable du mérite réel d’une personne. Il n’y a pas de mérite ou de « réussite » purement individuelle dans un système où règne la division du travail. La grande fortune est articulée à un système de prédation plus qu’à des qualités personnelles. Les patrons et les actionnaires milliardaires des GAFAM, profitent d’une fiscalité avantageuse et pratiquent l’évasion fiscale, ils ont bâti leurs empires sur des subventions et sur l’apport de services publics payés par la collectivité. Ils profitent non seulement de la plus-value extorquée à leurs salariés et des prix de monopoles frappant les consommateurs, mais aussi de l’ensemble des connaissances accumulées et gracieusement offertes par l’humanité.
Notons que cette coopération invisible de tous les humains dans le temps et dans l’espace est une idée déjà présente dans le solidarisme de Léon Bourgeois. Marx la préfigurait en énonçant la contradiction entre « le caractère social de la production » et « l’appropriation privée des moyens de production » : il l’avait bien vu, la propriété n’est pas une affaire individuelle, mais un « rapport social ».
Il y a donc une dette de chacun envers la collectivité. Une dette que certains milliardaires tentent de solder par une généreuse philanthropie, déductible des impôts. Cette bonne conscience monnayée ne peut masquer le vide éthique et le danger politique d’un système qui construit d’aussi extrêmes inégalités. La sécession de certaines catégories de la population, est d’abord et avant tout le fait de ces super-privilégiés qui ne sont pourtant pas les derniers à dénoncer le « séparatisme » des autres.
Concluons : la « juste inégalité » des revenus reste, pour l’instant, indéfinissable en dehors de sa perception subjective.
III. Petite histoire de la fiscalité dans le régime propriétariste
La levée d’impôts accompagne la construction de l’Etat centralisé moderne en Europe, depuis la fin du Moyen-Âge. Fiscalité directe (taille), indirecte (gabelle) à quoi s’ajoutent la fiscalité seigneuriale et celle du clergé (dîme), s’agissant de la France. Les révoltes antifiscales des croquants et des va-nu-pieds ponctuent l’histoire, et la crise financière de la Monarchie n’est pas pour rien dans l’explosion de 1789. La Révolution tente de remodeler ce système dans un sens égalitaire, appuyé sur le consentement de la Nation. En réalité, le 19ème, siècle de la bourgeoisie, modèle le système fiscal selon ses propres intérêts de classe.
La capacité fiscale de l’Etat reste encore très limitée, elle était au 16ème siècle de 1 à 2% du revenu national, et monte péniblement à 10% en 1910. Les dépenses militaires en consument une bonne part. L’endettement est un recours fréquent, ce qui a contribué, avec le commerce international, au développement des marchés financiers.
Les guerres mondiales, une fois tourné le chapitre des carnages, ouvrent sur celui des investissements sociaux, éducatifs et sanitaires qui deviennent, après 1945, une priorité et exigent des ressources inédites. Les prélèvements atteignent bientôt, dans les pays développés, 30 à 50% du revenu national et se partagent en trois parts à peu près égales : impôt sur le revenu et sur les bénéfices, cotisations sociales, TVA et autres taxes, à quoi s’ajoute une petite part sur le patrimoine et les successions.
Dans les pays pauvres, avec le mouvement de libéralisation forcée abaissant les droits de douane et avec l’évasion à l’étranger d’une bonne partie des revenus locaux, les ressources fiscales sont d’environ 15% du PIB, insuffisant pour l’investissement éducatif et sanitaire.
Les Etats-Unis, comme pays des extrêmes
Les Etats-Unis fournissent un cas tout à fait étonnant. Dans la période qui va de 1932 à 1980, à travers le New Deal, la Guerre mondiale et l’après-guerre, le taux d’imposition le plus élevé appliqué aux revenus est en moyenne de 81% et monte à certains moments à plus de 90%, à quoi s’ajoute le taux des Etats (5 à 10%) tandis que le taux marginal sur les successions est en moyenne de 75%.
La « révolution conservatrice » de Reagan effondre le taux marginal d’impôt sur le revenu à 28%. L’impôt fédéral sur les sociétés passe de près de 50% à 21%. Le capital est peu taxé. Warren Buffett, l’homme qui veut payer plus d’impôt et léguer 99% de sa fortune à des fondations, verse en attendant 0,003% de son patrimoine de 65 milliards de $ aux impôts !
Le mouvement de baisse des prélèvements, contamine tous les pays riches, appliquant le dogme libéral de la réduction des dépenses publiques et du rétrécissement de l’Etat-Providence. Comme, à y regarder à la loupe, les plus fortunés profitent le plus des coupes d’impôts, ce sont les « classes moyennes » qui payent pour les cadeaux fiscaux et l’évasion fiscale des autres.
Digression : l’impôt en France [4]. Le lecteur pressé pourra sauter à la case suivante
La Révolution avait aboli les impôts indirects et la Convention avait établi, pour la première fois, un impôt progressif. Napoléon rétablit la fiscalité indirecte et revient à la proportionnalité. Ce n’est qu’en 1914, qu’est instauré le premier impôt sur le revenu progressif avec un taux marginal de 2%, destiné à financer les charges de la défense nationale.
L’impôt sur le revenu actuel a comme taux marginal 45% pour une personne seule, au-dessus de 158 000 € de revenu annuel (2021). La combinaison du quotient familial et des allocations familiales, malgré l’existence de plafonds, avantage les revenus élevés et désavantage les ménages non imposables. Dans un système raisonnablement égalitaire, chaque enfant ayant « la même valeur » devrait procurer le même avantage fiscal, c’est-à-dire un avantage « forfaitaire ».
Quant à l’impôt sur les revenus du capital, il prend, depuis 2018, la forme d’un « Prélèvement Forfaitaire Unique », couramment appelé flat tax, au taux unique de 30%. Le gâteau laissé aux plus riches est énorme, puisque les actifs financiers détenus en France sont passés de 3x le Produit Intérieur Brut en 1980 à 11x en 2018…
L’impôt sur le patrimoine (ou, selon les dénominations, sur le capital, sur la fortune, sur la propriété), existe, depuis le 18ème siècle, avec un taux faible, proportionnel, peu inquisitorial et il a longtemps exonéré les actifs financiers alors que ceux-ci représentent le plus gros des gros patrimoines.
En fait partie la vénérable taxe foncière, souvent injuste pour les particuliers et les entreprises puisqu’elle est indépendante du revenu. C’est aussi le jeune impôt sur la fortune : IGF (1982), supprimé puis réapparu en ISF (1989, pour financer le RMI), devenu IFI (i pour immobilier, 2017) avec une assiette rabougrie puisque les actifs financiers n’en font plus partie. L’IFI touche moins de 0,4% des contribuables, pour un taux maximum de 1,5%.
L’impôt sur les successions apparaît en 1799 avec un taux unique de 1% destiné à l’enregistrement. Il devient progressif en 1901 avec un taux marginal de 6,5%, pour financer la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. C’est un impôt assez facilement contourné. En ligne directe, son taux supérieur actuel est de 45%, applicable au-dessus de 1,8 million d’euros (2020). Famille oblige, il est l’impôt le plus impopulaire, quoiqu’il ne touche qu’une minorité de la population.
La TVA, instaurée en France en 1954, est le principal impôt indirect. C’est une taxe à caractère régressif (elle pèse plus sur les ménages modestes que sur les ménages aisés), malgré le taux réduit pour les biens de première nécessité.
Les cotisations sociales obligatoires sont un autre type de prélèvements tout en étant une forme de salaire différé. Elles apparaissent dans l’Allemagne de Bismarck à partir de 1881 pour financer la maladie et la vieillesse. 1945, en France, généralise le système des assurances sociales avec ses différentes branches. La protection sociale ajoute au système assurantiel un système de solidarité (RMI) payé par l’impôt. L’ensemble réduit sensiblement les inégalités de revenu dans un pays comme la France, malgré ses nombreuses insuffisances et les trous de son maillage.
Le montant total des prélèvements obligatoires en France se situe autour de 45% du PIB, taux le plus élevé au monde. On verra que Piketty propose de le porter à 50%.
Du coup, jusque dans l’UE, certains Etats pratiquent le dumping fiscal (Suisse, Luxembourg, Irlande, Pays-Bas, etc.) et profitent de l’évasion fiscale (îles Anglo-Normandes, Malte, etc.). Ces pays siphonnent les recettes fiscales des autres pays. Bien que ce soit contradictoire avec le dogme libéral d’une concurrence libre et non faussée, le néolibéralisme affirme que c’est bénéfique pour tous, car cela contient vers le bas les taux de prélèvements et par conséquent les dépenses publiques ! L’unification fiscale est encore une rêverie.
IV. Une « social-démocratie » revisitée
Avant d’en venir aux mesures proposées par Piketty, interrogeons-nous sur son cadre de référence politico-idéologique. C’est la « social-démocratie » entendue en un sens générique. Piketty n’est pas un économiste libéral mais pas non plus un économiste marxiste. Il n’est pas sûr qu’il saisisse le cœur du capitalisme et sa fabrique du profit, ce pourquoi il s’attaque aux effets (le capital-propriété, le patrimoine accumulé) plutôt qu’aux causes (le capital-fonction, la propriété des moyens de production), mais il faut lui reconnaître une volonté radicale de démanteler les inégalités.
Il réfère à ce qui appelle « l’âge d’or de la social-démocratie », les années 1950-1980, durant lesquelles l’Allemagne invente le concept d’« économie sociale de marché » et pratique la « cogestion » dans les entreprises, sans pour autant casser les syndicats. Cette social-démocratie ne fait plus rêver aujourd’hui, Piketty le reconnaît. Quoi qu’il en soit, notre auteur se situe dans la perspective d’une social-démocratie « authentique » qui aurait renouvelé son programme et pratiquerait l’« encastrement social » de l’économie.
Le « retournement du clivage éducatif » des partis de gauche
Les partis sociaux-démocrates et autres, situés à gauche de l’éventail politique, recueillaient les suffrages des moins diplômés et des personnes à revenu et patrimoine faibles jusque dans les années 1970. A partir des années 1990, ce sont les plus diplômés qui votent à gauche, tandis que le vote ouvrier s’effondre. Un point que confirme la bascule de Paris d’une rive à l’autre. Les classes populaires ont été abandonnées par la gauche institutionnelle qui a renoncé à son référent égalitaire et se consacre aux gagnants de la compétition éducative. Ou, ce qui revient au même, les classes populaires ont déserté les partis de gauche, attirés par les sirènes de ceux que Piketty appelle les « social-nativistes », les partis « identitaires », ceux qui tracent une frontière entre « eux » et « nous » en manipulant l’enjeu migratoire. Ces partis détricotent le clivage classiste au profit d’un clivage racialiste, tout en opposant le « peuple » et les « élites ». C’est d’une grande violence pour tous ceux qui vivent une identité mélangée. [5]
Ce phénomène que Piketty appelle « retournement du clivage éducatif » touche la plupart des pays développés. S’y ajoute un spectaculaire retrait citoyen par l’abstention.
Piketty veut donc reconstituer une coalition égalitaire réunissant les classes populaires issues de différents trajectoires (urbains et ruraux, salariés et non-salariés, nationaux et non nationaux) et qui soit capable de bouleverser le régime de propriété.
La propriété, mais jusqu’où ?
Une propriété strictement privée et relevant d’un droit inviolable, quel que soit le montant de sa valeur, ne résiste pas à l’analyse, nous dit Piketty. L’accumulation de biens est toujours le fruit d’un processus qui ne peut être abstrait de la dette sociale dont nous avons parlé. Il en résulte qu’il est normal que les détenteurs d’un patrimoine en rendent une fraction chaque année à la communauté. Surtout à partir d’un certain montant qui excède ce qu’il est possible d’accumuler par une « juste » rémunération au cours d’une vie de travail.
Or, en dehors d’un effacement radical de la frontière entre le propre et le commun, il n’y a que trois manières de dépasser le système dominant de la propriété privée.
Première manière, par la propriété publique étatique (les nationalisations), idée en crise après la chute du « communisme » à la soviétique. Il n’y a plus aujourd’hui de programme crédible pour un monopole de la propriété étatique. Ajoutons que la Chine, après la mort de Mao, s’est convertie, au prix d’un grand écart, à une « économie socialiste de marché » …
Deuxième manière, par la propriété sociale. Ainsi la cogestion à l’allemande : les représentants des salariés ont la moitié des sièges dans les conseils de surveillance. S’ajoutent l’actionnariat salarié et la participation aux bénéfices, toutes mesures digérables par le libéralisme. Existent aussi les coopératives, associations, fondations, un sujet malheureusement survolé par Piketty qui se contente d’affirmer que l’organisation coopérative n’est pas une solution généralisable.
Troisième manière, par la « propriété temporaire » et l’« héritage pour tous ». C’est là l’originalité de Piketty qui veut déconcentrer la propriété, la faire circuler et permettre ainsi sa diffusion vers de nouveaux groupes sociaux (en particulier les jeunes) au moyen d’une « dotation en capital universelle ».
La propriété temporaire et la dotation en capital
Cette dotation en capital se monterait à 60% du patrimoine moyen (120 000 € environ en France aujourd’hui) et serait versée inconditionnellement à chaque jeune adulte de 25 ans. Chacun pourrait en faire l’usage qu’il souhaite… la dilapider, l’investir en Bourse, acquérir un logement, se lancer dans un projet personnel ou collectif, suivre une formation, mener une action bénévole, inaugurer un changement de vie… Elle permettrait à chacun d’accroître son pouvoir de négociation face aux employeurs. La propriété d’un capital est ici clairement valorisée en tant que facteur de liberté et de créativité.
Cette dotation coûterait 5% du revenu national et serait financée par un impôt annuel unique sur la propriété, une sorte d’impôt sur la fortune généralisé, doux pour les petits patrimoines, cruel pour les grosses fortunes, complété par l’impôt sur les successions. Les deux seraient portés jusqu’au taux maximum de 90% pour les patrimoines égaux à au moins 10 000 le patrimoine moyen [soit environ 2 milliards d’€], ce qui représente des taux inédits, quasiment confiscatoires. [6]
L’argument est éthique : on l’a dit, toutes les richesses sont sociales et reposent sur des biens communs. Cette part commune est incalculable, mais elle justifie la remise en cause de l’accumulation du patrimoine par quelques-uns et les privilèges transmis par la naissance. D’où le projet d’abolir (partiellement) l’héritage matériel, le seul directement saisissable, et de le verser à la communauté ou de le redistribuer équitablement, n’en déplaise à la sacro-sainte transmission du trésor familial. C’est l’idée subversive d’une propriété temporaire.
Au préalable il faudrait établir un cadastre financier public universel : qui possède quoi en matière d’actifs financiers ? Aujourd’hui, ces données sont retenues par des organismes privés (Clearstream, par exemple). Les statistiques sont pauvres, la transparence, même si elle a progressé, laisse des pans entiers de la capitalisation financière dans l’obscurité. Evasion des bénéfices d’activités licites et argent du crime organisé se mêlent dans les « paradis fiscaux », pendant que les pauvres sont en enfer.
Revenu minimum et revenu maximum ?
S’agissant des revenus, Piketty combine une action sur les bas revenus (« revenu de base ») et une action sur les très hauts revenus.
Le « revenu de base » n’est pas un « revenu universel d’existence » mais un revenu minimum garanti à tous, déduction faite des autres revenus, est-il précisé, et versé sans contrepartie. Il repose sur le principe d’un accès de tous aux biens fondamentaux tels qu’ils sont historiquement définis. Un revenu de base inférieur au seuil de pauvreté existe déjà dans de nombreux pays européens, dont la France, avec le RSA [565 € pour une personne seule en 2021]. Il s’agirait de le rendre automatique (c’est-à-dire sans qu’il doive être sollicité) et il serait versé sur la fiche de paye ou sur le compte bancaire pour un montant égal à 60% du revenu moyen net (lequel définit aujourd’hui le seuil de pauvreté). Le sort des autres prestations sociales n’est pas examiné par Piketty.
Il faut improviser le calcul et les effets de cette mesure à la place de Piketty qui ne s’étend pas aux détails : cela nous mène aux alentours d’un SMIC net (1231 € en 2021 en France), considéré donc comme le salaire de base de référence. Seuls seraient impactés, semble-t-il alors, les travailleurs à temps partiel, les sans emploi, les 18-25 ans, aujourd’hui exclus du RSA. Cela signifierait qu’il n’y aurait pas de différentiel entre le revenu d’une personne sous-employée ou sans emploi et celui d’un smicard, ce qui interpelle et ouvre à un débat qui ne peut être poursuivi ici. En tout état de cause, ce revenu de base, nous dit Piketty, s’appliquerait à 30% de la population et « coûterait » 5% du revenu national.
L’impôt sur le revenu (Piketty inclut dans son calcul les cotisations sociales et la taxe carbone) serait prélevé sur tous les revenus, jusqu’à 90% de taux effectif pour un revenu égal à 10 000 fois le revenu moyen [soit environ 260 millions d’€]. Un taux encore une fois inédit et quasiment confiscatoire, qui écraserait l’éventail des revenus. Non pas donc un revenu maximum, mais un écrémage radical – une abomination pour les nantis ! [5b]
Ainsi, « l’Etat social et écologique » serait financé par l’impôt sur le revenu, incluant les cotisations sociales et la taxe carbone, au total un prélèvement de 45% sur le revenu national dont 5% destinés au revenu de base. S’ajouteraient les prélèvements sur le patrimoine et les successions, dont on a parlé, à hauteur de 5% du revenu national, pour financer la dotation en capital, soit au total 50% de prélèvements.
Revenu de base ou revenu universel d’existence ?
Piketty n’explique pas en détail pourquoi il préfère un « revenu de base garanti » à un « revenu d’existence universel » qu’il avait pourtant semblé soutenir lorsqu’il était entré dans l’équipe de campagne de Benoit Hamon en 2017.
Il se contente de citer le double héritage contradictoire de l’idée de revenu universel, celui de Thomas Paine et celui de Milton Friedman. Rappelons, pour notre part, que le premier est ce révolutionnaire britannique, élu député à la Convention et précurseur du revenu de base dans son livre La Justice agraire (1797) ; en réalité Thomas Paine justifie plutôt la dotation en capital puisqu’il cite la coutume des Indiens Cherokee qui attribuent un lopin de terre à chaque nouvel adulte majeur. Le second est cet économiste néolibéral de l’école de Chicago, qui a initié, dans Capitalisme et liberté (1962), l’idée d’un allocation universelle, définie comme un impôt négatif. L’arrière-pensée en était de réduire la voilure de l’Etat, déréguler l’économie et liquider la protection sociale.
Les seuls arguments formulés trop rapidement par Piketty sont que le revenu de base s’appuie sur la relation travail alors qu’un revenu universel affaiblit le lien au travail, favorise l’hyper-flexibilité, a un coût fiscal trop élevé. L’argument n’est pas entièrement convaincant puisque le revenu de base, comme d’ailleurs la dotation en capital, ne semblent pas exempts de ces mêmes effets.
Il n’y a pas lieu ici de poursuivre le débat sur la question revenu de base / revenu d’existence. Remarquons juste, pour conduire la proposition de Piketty jusque dans ses ultimes conséquences, qu’un revenu universel ne réduit les inégalités qu’à la marge, tandis que la proposition combinée d’un prélèvement radical sur les très hauts revenus et d’un revenu de base, les réduit fortement.
Piketty reste pris dans un mode de pensée éthico-libéral, mais aussi bien néo-marxiste, quand il maintient fermement la conjonction entre travail et revenu, alors que la tendance des sociétés « développées » (mais certes pas des sociétés pauvres) consiste à les disjoindre, parfois même jusqu’à développer le fantasme d’une fin du travail.
Capital éducatif universel
Après le revenu de base et la dotation en capital, troisième volet. Piketty remarque que, pendant un siècle (1850-1950) l’avance des Etats-Unis a été significative en termes d’éducation, de productivité et de niveau de vie, trois dimensions corrélées. En 1850 il y avait, dans ce pays, 90% de scolarisation en primaire (chez les Blancs), alors qu’en Europe, c’était moins de 30% ; dans le secondaire, en 1960, c’était 80% contre 30% en Europe. Mais au final, aujourd’hui, 1 enfant sur 5 seulement fait des études supérieures parmi les familles pauvres américaines, contre 9 sur 10 chez les 10% les plus riches.
Les pays européens sont aussi mal lotis et même, tout particulièrement, la France qui se réclame pourtant de l’« école républicaine ». L’« ascenseur social » est en panne depuis la fin des Trente Glorieuses. Comme l’a bien montré Pierre Bourdieu, autant que le capital financier, c’est le capital culturel des parents qui maintient les inégalités de réussite scolaire.
Dans notre pays, les 10% de jeunes les mieux lotis en études « coûtent » 200 à 300 000 € à la communauté, les 10% les moins bien lotis 65 à 70 000 €. Les « filières élitistes » (classes prépas) piochent dans le budget de l’Etat trois fois plus que les filières universitaires.
Pour contrer ces dérives, Piketty propose d’établir un droit à une même dépense d’éducation pour tous, sous la forme d’un « capital éducatif » à utiliser tout au long de la vie [soit donc quelque chose comme 300 000 €, incluant toutes les dépenses couvertes par les budgets publics et la scolarité obligatoire]. Quoiqu’il ne l’évoque pas, cette mesure est à distinguer de l’idée ultralibérale du « chèque éducation » mis à disposition des familles. Pour répondre à la stagnation de l’investissement éducatif depuis les années 1980, la part de l’éducation serait portée de 6% à 9% du revenu national, afin de redistribuer l’héritage culturel au même titre que l’héritage matériel.
Haro sur les taxes sauf exception
Piketty est partisan de la suppression des impôts indirects (TVA) considérés comme très régressifs, exception faite de la taxe sur les émissions carbone, essentielle pour sauver la planète. Il remarque qu’une taxe carbone proportionnelle frappe inégalement les riches et les pauvres, les pays du Nord et les pays du Sud. On l’a bien vu en 2017, avec le projet de hausse de la fiscalité carbone qui a valu l’explosion des Gilets jaunes. Cette hausse finançait en réalité la suppression de l’ISF et non la transition écologique, elle frappait de plein fouet les dépenses contraintes des classes modestes. Un traitement juste de la question des émissions carbone passe par l’exonération de la première tranche de consommation des énergies fossiles et par le subventionnement de la transition vers d’autres énergies pour les plus pauvres.
Un emploi pour tous
Un article récent de Thomas Piketty comble une absence dans la démonstration de Capital et idéologie à propos du revenu de base et propose d’ajouter un système de garantie de l’emploi qui n’est pas sans faire penser à une généralisation de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur longue durée », lancée en France en 2017. [7]
Partage du pouvoir dans les entreprises
Enfin, Piketty veut réduire les inégalités dans le pouvoir de gestion du capital. Approfondissant le modèle de cogestion à l’allemande, il imagine un partage de la représentation dans les conseils d’administration des entreprises privées ou même publiques : détenteurs du capital (avec un plafonnement du droit de vote des gros actionnaires), salariés, Etat et collectivité publiques, société civile (usagers, consommateurs).
Récapitulons
Revenu minimum et revenu maximum, ou, plus exactement, écrasement des très hauts revenus ; dotation universelle en capital ; garantie d’emploi; capital éducatif universel ; taxe carbone modulée ; partage du pouvoir dans les entreprises. Et aussi : création d’un service public bancaire, gratuit et accessible à tous ; cadastre financier universel. Le tout au prix d’une véritable révolution fiscale destinée à décapiter les inégalités extrêmes pour nous ramener à de « justes inégalités ».
NI abolition, ni sacralisation donc, mais régulation de la propriété privée. La justification ultime de cette idée tient dans cet argument : « Dans la mesure où elle [la société juste] permet d’améliorer les conditions de vie et d’accroître l’étendue des opportunités ouvertes aux plus défavorisés, alors l’inégalité des revenus et de propriété peut être juste. Mais ceci doit être démontré et non supposé, et cet argument ne doit pas être utilisé pour justifier n’importe quel niveau d’inégalité, comme cela est trop souvent fait » (page 1113). C’est un argument ancien, de type libéral, reformulé par John Rawls (Théorie de la justice, 1971) [8] et repris ici par Piketty. L’argument est recevable, mais en appelle à une démonstration impossible du « juste » niveau d’inégalités.
V. Quelques limites du propos de Piketty
Partage du pouvoir et du savoir, nouvelle répartition des revenus et du capital, cela suffit-il à un « dépassement du capitalisme » ? C’est douteux. Piketty le reconnaît, le capitalisme est caractérisé par sa capacité inouïe d’adaptation qui lui a permis de résister aux tourmentes des deux derniers siècles (qu’il a lui-même provoquées) et d’inventer, à chaque fois, un discours qui fasse sens et qui ait un semblant de vérité pour « justifier » les inégalités qu’il creuse.
L’idée des biens communs est trop brièvement évoquée [9]; Piketty n’imagine aucune dépassement de la propriété vers un usage partagé des biens. Le capital de type coopératif est négligé, la notion d’économie sociale et solidaire est absente. A l’autre extrémité, le sort du capital transnational n’est pas tranché.
Autre regret: la propriété est interrogée plus que le travail. Piketty ne pose pas la question du sens du travail, dans ses formes multiples, entre aliénation et accomplissement de soi, ni les questions très concrètes de conditions de travail, de durée de travail, de discrimination au travail. Il fait l’impasse sur les inégalités de salaire entre pays du Nord et pays du Sud, qui ont un caractère structurant dans l’économie mondialisée actuelle (destruction d’emplois ici, création d’emplois sous-payés ailleurs, marchandises à bas coût).
Bien qu’il se réclame d’une science économique encastrée dans les sciences sociales, le concept de Piketty reste celui d’un économiste féru de statistiques macroéconomiques. Or, on le sait, les statistiques ne sont pas exemptes de biais, elles fonctionnent par agrégats, et font écran à la réalité humaine sous-jacente. Les luttes sociales sont quasiment absentes du propos. Il n’y a pas de référence aux multiples points de résistance, d’innovation sociale, d’action et de coopération citoyennes qui surgissent spontanément dans la société, ni de réflexion sur les conditions de leur convergence dans une traduction politique.
Croissance, inégalités et écologie
Plus inquiétante est l’articulation implicite entre croissance et réduction des inégalités. Piketty constate, en effet, qu’il y a une corrélation entre impôt progressif, croissance économique et baisse des inégalités, corrélation avérée lors de l’entre-deux-guerres et durant les Trente glorieuses. A l’inverse, les coupes dans les impôts, le ralentissement de la croissance et la montée des inégalités caractérisent la période de la Belle Epoque et celle qui commence au tournant ultralibéral des années 1980.
C’est donc en période de croissance économique forte que le système peut distribuer de façon plus égalitaire les richesses, tandis qu’en période de croissance faible, le capitalisme cherche à maintenir son taux de profit au-dessus du taux de croissance par une prédation accrue : c’est le mécanisme fondamental qui conduit à concentrer le patrimoine et à creuser les inégalités. Faut-il donc faire repartir à tout va la croissance quite à se fracasser sur la destruction de la nature ? Piketty reste assez muet sur ce point.
L’écologie est le parent pauvre de son raisonnement, alors que le dérèglement climatique va faire exploser les inégalités et la pauvreté. Il n’aborde quasiment le sujet que par le biais de la taxe carbone. Or seule la décroissance – ou, si l’on préfère, une croissance différenciée, inclusive et de transition – est notre horizon si l’on veut préserver la planète, réduire les inégalités, et éviter les dérives autoritaires.
Revenu et qualité de vie. Un dépassement du capitalisme ?
Enquêtant sur les sociétés développées, Piketty laisse de côté les inégalités entre les pays du Nord et ceux du Sud et les inégalités internes à ces derniers. Ses propositions phares paraissent pourtant applicables aux pays pauvres, une fois que seraient redéfinis les rapports Nord/Sud. Dans un article récent, Piketty reprend l’idée d’un impôt mondial de 2% sur les grandes fortunes qui rapporterait 1000 milliards d’€ (soit 1% du PIB mondial) et permettrait de financer un droit à la santé et à l’éducation pour tous, en remplacement de l’aide publique internationale qui plafonne péniblement à 0,2% du PIB mondial.
S’agissant de la fiscalité à l’échelle mondiale, Piketty n’aborde pas dans Capital et idéologie la question de la taxation des GAFAM ni celle des transactions financières ultrarapides. Un frémissement vient d’avoir lieu au G7, le 4 juin 2021 : l’accord préliminaire pour instaurer un taux minimum mondial d’imposition d’au moins 15 % des multinationales. Dans un autre article récent, Piketty qualifie ce projet de « véritable permis de frauder pour les acteurs les plus puissants » alors que tous les autres, particuliers et entreprises, sont imposés à des taux bien supérieurs.
Piketty réfléchit à une distribution plus équitable des richesses monétaires mais néglige la question des inégalités dans la qualité de vie et de travail : il nous reste à inventer de nouvelles formes de vie soutenables qui nous sortent du face à face narcissique et dépressif avec un environnement saturé d’Images et de marchandises, et à imaginer de nouvelles formes de travail coopératives pour sortir de la subordination et de la division du travail abrutissantes.
Piketty parle de dépassement du capitalisme. Oui, le capitalisme a atteint ses limites – et celles de la planète. Mais s’agit-il ici d’un réel dépassement ou juste d’une inflexion radicale ? Piketty restreint son sujet aux inégalités « acceptables », sans interroger de façon décisive ce qui produit et reproduit ces inégalités : l’auteur soigne la maladie, sans guérir le malade. Il s’enquiert de la distribution des richesses, sans l’articuler à la construction d’une coopération qui permette de faire un monde véritablement commun. C’est sans doute trop demander à un seul livre.
Notes
[1] Formation du salaire. Le néoclassicisme (Walras) explique la formation du salaire par l’offre et la demande sur le marché du travail. Le keynésianisme, en héritier d’Adam Smith, met l’accent sur la négociation entre employés et employeurs, forme soft de la lutte des classes façon Marx. La question des « justes » inégalités de salaire n’a guère de sens dans le néoclassicisme, elle en a à peine plus avec Keynes, tandis que pour Marx l’émancipation finale passe par l’abolition du salariat.
Rappelons l’orthodoxie marxiste : le salaire ne représente pas la valeur du travail de l’ouvrier mais la valeur de sa force de travail. La force de travail (seule chose à vendre que possède l’ouvrier) est une marchandise qui a une valeur d’usage (celle de produire des marchandises) et une valeur d’échange. Cette valeur d’échange est déterminée par le temps de travail nécessaire à sa reproduction, c’est-à-dire par la valeur des moyens de subsistance nécessaires à son entretien, à celui de ses enfants et aux frais de qualification. C’est cette valeur qui apparaît sous forme de salaire. – Le mystère du profit capitaliste est que la force de travail a ce pouvoir extraordinaire de produire plus de valeur qu’elle n’en possède. Selon l’exemple classique, le capitaliste a acheté l’usage d’une force de travail pendant une journée, mais le travailleur a produit la valeur de sa force de travail (salaire) durant la matinée, et l’après-midi, il a travaillé gratuitement, générant une plus-value empochée par le capitaliste (profit). Ce mécanisme se déroule à l’insu des protagonistes. Une lutte des classes en découle. L’ouvrier se bat pour augmenter la valeur de sa force de travail, toujours à la limite de la survie, le capitaliste cherche à majorer sa plus-value pour augmenter son taux de profit. – Le projet révolutionnaire dessiné par Marx est celui de l’abolition de la propriété privée des moyens de production (donc l’abolition du profit privé) et la généralisation du salariat combinée à des biens « gratuits » : socialisme, « à chacun selon son travail ». Dans un stade ultérieur, extinction du salariat : communisme, « à chacun selon ses besoins », avec le rêve d’une relative abondance, auquel il faut bien substituer aujourd’hui un futur de frugalité.
[2] Liberté, égalité, propriété. Les deux premières sont ici admises comme des valeurs universelles, valeurs sociales au moins autant qu’individuelles. Ce sont des réciproques : pas l’une sans l’autre, sous la forme d’une égale liberté. Ce pourquoi aussi liberté et limitation de la liberté sont inséparables : il n’y a pas de liberté sans loi – sans une loi juste, faite de droits mutuels – faute de quoi ne règne que le pur rapport de forces. Le mariage de la liberté et de l’égalité est inséparable d’un régime démocratique qui partage le pouvoir et diffuse le savoir. La propriété, par contre, n’est pas un universel au même titre. Elle intervient comme un perturbateur, elle rend plus ou moins égal, plus ou moins libre, plus ou moins puissant, d’où le propos de Piketty qui rappelle, à certains égards, l’idéal proudhonien de la petite propriété individuelle, idéal qui a nourri également le discours affiché par la III° République. Dans la devise républicaine vient un troisième terme, plus ou moins bien choisi, celui de fraternité. Il indique qu’une société ne peut faire monde commun sans un lien affectif, sans des « passions joyeuses ».
[3] Compensation aux esclavagistes. Le cas de Saint Domingue (Haïti) est particulièrement significatif, puisque ce pays « payera » l’indépendance qu’il arrache à la France jusqu’en 1950. – Le cas des Etats-Unis est différent. Les esclavagistes, ayant conduit à la fratricide Guerre de Sécession et ses 600 000 morts, ne seront pas indemnisés. Mais les « 40 acres et une mule » promis aux affranchis resteront lettre morte, et la pleine citoyenneté ne leur sera acquise qu’un siècle plus tard.
[4] Types d’impôts. Rappelons qu’il y a deux types de prélèvements : les impôts, les cotisations sociales. Deux types d’impôts : directs, indirects. Deux types d’impôts directs : sur le revenu, sur la propriété. Deux types d’impôts sur la propriété : sur le patrimoine, sur les successions. Deux modalités sont possibles : la proportionnalité (% égal pour tous), la progressivité (% croissant).
[5] Retournement du clivage éducatif. Notons cette exception : les Français « musulmans » représentent 5% de l’électorat et votent à 70-90% pour la gauche. Cela peut faire basculer une élection. Piketty note au passage que moins d’un quart des « musulmans » déclarés sont pratiquants et qu’à peu près autant se déclarent sans religion. – L’histoire des Etats-Unis montre aussi les transformations paradoxales du Parti démocrate, parti des esclavagistes, puis parti des classes populaires, et enfin parti des minorités et des plus diplômés.
[6] Projet d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la propriété. Voir Tableau 17.1 page 1130 : Les taux d’imposition indiqués sont des taux effectifs et non pas des taux marginaux. Le patrimoine moyen est d’environ 200 000 € en France à l’heure actuelle, dit Piketty. 10 000 fois ce patrimoine, cela porte à 2 milliards d’euros. D’après mes calculs, avec le barème proposé, un tel patrimoine, s’il n’est pas abondé, tombe en six ans à 751 000 € par l’effet de l’impôt sur la propriété.
S’agissant de l’impôt sur le revenu, les comparaisons ne sont pas faciles car Piketty inclut dans son montant les cotisations sociales et la taxe carbone (tous prélevés, en quelque sorte, à la source). Ainsi s’explique, me semble-t-il, le 10% d’imposition sur les faibles revenus. – Le revenu moyen actuel en France est difficile à trouver ; le revenu médian disponible est mieux connu, il est d’environ 1800 € en France en 2020 pour une personne seule. A titre indicatif, le salaire moyen est de 20% supérieur au salaire médian. Le seuil de pauvreté est à 60% du revenu médian soit 1063 € en France, en 2020.
Piketty signale que des taux confiscatoires ont existé en 1945, en France, lorsqu’un impôt exceptionnel et progressif a été levé sur le capital et les enrichissements survenus pendant l’Occupation, jusqu’à 20% de la valeur des patrimoines, 100% dans certains cas. Du coup, la dette publique de la reconstruction, qui représentait 270% du PNB en 1950 est résorbée en peu d’années, grâce aussi à l’inflation. Ça pourrait donner des idées.
[7] Garantie d’emploi. Je cite ici un extrait du texte posté le 15 mai 2021 sur le blog de Piketty, sous le titre « La solution la plus simple pour diffuser la richesse est l’héritage pour tous » :
« Un outil plus ambitieux qui pourrait être mis en place en complément du revenu de base est le système de garantie d’emploi, récemment proposé dans le cadre des discussions sur le Green Deal (La Garantie d’emploi. L’arme sociale du Green New Deal, de Pavlina Tcherneva, La Découverte, 2021). L’idée est de proposer à toutes les personnes qui le souhaitent un emploi à plein temps au salaire minimum fixé à un niveau décent (15 dollars [12,35 euros] par heure aux Etats-Unis). Le financement serait assuré par l’Etat et les emplois seraient proposés par les agences publiques de l’emploi dans le secteur public et associatif (municipalités, collectivités, structures non lucratives). Placé sous le double patronage de l’Economic Bill of Rights proclamée par Roosevelt en 1944 et de la Marche pour l’emploi et la liberté organisée par Martin Luther King en 1963, un tel système pourrait contribuer puissamment au processus de démarchandisation et de redéfinition collective des besoins, en particulier en matière de services à la personne, de transition énergétique et de rénovation des bâtiments. Il permet aussi, pour un coût limité (1 % du PIB dans la proposition de Mme Tcherneva), de remettre au travail tous ceux qui en sont privés pendant les récessions et d’éviter ainsi des dommages sociaux irrémédiables. »
[8] Rawls Théorie de la justice (éd. Seuil). Dans cette œuvre importante, Rawls définit la justice comme équité (fairness) et veut concilier liberté et égalité au moyen de principes virtuellement « préférables » par tous les individus rationnels. Son « principe de différence » se résume ainsi : « Les inégalités économiques et sociales doivent être telles qu’elles soient : a) au plus grand bénéfice des plus désavantagés » (c’est là le point énigmatique qu’il discute longuement) et b) « attachées à des fonctions et à des positions ouvertes à tous, conformément au principe de la juste égalité des chances. » (Théorie de la justice p.341).
On retrouve également sur cette ligne l’économiste Amartya Sen et la philosophe Martha Nussbaum qui cherchent à formuler une théorie concrètement applicable. D’où les notions de « capabilité » et de « qualité de vie ». Il s’agit de donner à chacun – et particulièrement aux plus vulnérables – la capacité de disposer des choix de vie les plus larges possibles, en levant, par des politiques publiques, les obstacles qui restreignent les pouvoirs d’être et d’agir. On est toujours dans un cadre de pensée « social-démocrate », au sens générique du terme, avec l’individu au centre du projet.
[9] Biens communs. Voir à ce sujet, dans Paroles de traverse: « Le commun, une alternative ».
Références Le Capital au XXI° siècle (2013) et Capital et idéologie (2019) ont paru aux éditions du Seuil. – Les articles cités sont tirés du blog de Thomas Piketty.
